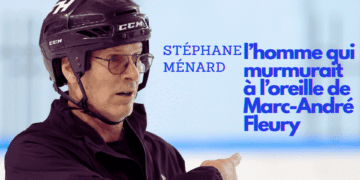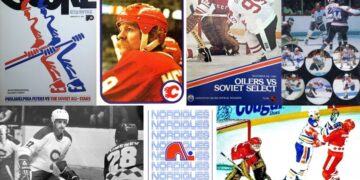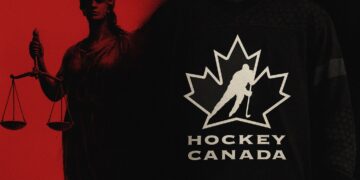Aussi exigeant sur la glace que affable en dehors, Ménard s’est forgé une réputation d’entraineur atypique, au point d’évoluer souvent à l’écart des circuits officiels. Nous l’avons rencontré à la fin d’une journée de stage spécifique pour jeunes gardiens âgés de 10 à 16 ans, qu’il coanime avec son complice Franck Constantin — déjà bien connu des lecteurs à travers notre série “Derrière le masque” (notamment dans les épisodes 1, et 4). HockeyArchives trace le portrait riche en anecdotes de cet homme de l’ombre, un entraîneur pas comme les autres, qui a fait de son franc-parler et de sa passion une véritable école de vie.
Un coach précoce et passionné
À seulement 19 ans, alors qu’il est encore un jeune gardien, Stéphane Ménard raccroche déjà les jambières pour devenir entraîneur de gardiens de but. « Mon parcours commence avec une passion pour l’esprit d’équipe. Au départ, je fais du hockey, pas à un gros niveau… J’étais gardien, mais j’ai toujours gagné des trophées du meilleur esprit d’équipe. Et ça me suit partout parce que j’étais déjà un rassembleur. » Fait amusant, c’est pourtant sur un autre terrain qu’il aurait pu percer. « J’étais très bon au baseball, premier frappeur. J’aurais pu faire une carrière dans une grosse équipe AAA. Mon coach m’avait dit : “Hé, on t’emmène au camp d’entraînement. Et tu fais l’équipe !” Mais j’ai trouvé un amour. Et j’ai tout arrêté. Dans la vie, je fais tout ou je ne fais rien. Je suis blanc ou noir, je n’ai pas de zone grise. »
Avec le recul, il reconnaît que sa carrière de gardien aurait peut-être pu être différente. « J’aurais pu faire carrière [au hockey] si j’avais forcé un peu. Ce qui m’a manqué ? Un entraîneur de gardien de but, probablement du même style que moi. Peut-être que je suis devenu coach justement pour compenser ce que je n’ai pas eu. Après je n’étais gros physiquement, ça n’aidait pas. » Dès ses débuts, Stéphane Ménard forge son style, loin des livres et de la théorie : « À ma première école de hockey en 1982 j’avais fait tout un beau cartable plein d’exercices pour changer toutes les 10 minutes. Et puis beaucoup de gardiens, parce que je croyais que c’était l’effet « wow » d’avoir beaucoup de gardiens. »
« Après quatre minutes sur la glace, j’ai réalisé que ça ne servait à rien : chaque gardien est différent. J’ai commencé à analyser les personnes avant les joueurs. »
Franchise et éthique de travail
Son crédo tient en deux mots : éthique et franchise. « J’ai toujours été dur, mais honnête. Et ça marche. », insiste-t-il. Pas question de flatter un gardien sous prétexte qu’il est professionnel, ni de ménager un junior en apprentissage. Avec un sourire en coin, il raconte une séance d’entraînement un peu particulière : « J’étais sur la glace avec Marc-André Fleury… et tout son monde : Crosby, Malkin, Letang… tout le monde ! Je les ai avertis : “Tu lances sur la balustrade ? Back-check à la bleue. Tu lances dans la baie vitrée ? Back-check au fond.” Ce n’est pas parce que tu es professionnel que je te flatte. »
Pour lui, la technique ne vient qu’après la dimension physique et mentale du poste. « Ce n’est pas compliqué : c’est un sport physique. Tu n’as pas confiance si tu es dans le doute, si tes jambes ne suivent pas. » Il se souvient d’un gardien de championnat universitaire américain : « Sa mère m’appelle : “Il n’a plus confiance, ça ne va pas bien. Mais ne lui dites pas que je vous ai parlé de confiance.” Alors je l’appelle : “Salut, ta mère m’a dit que tu n’as pas confiance !” (rires). » Après une séance vidéo d’une demi-heure et près de 1000 déplacements, le joueur est à bout.
« Après quatre minutes, il n’avait plus de jambes. Je lui ai dit : « on est en novembre, pourquoi tu n’as plus de jambes ? » Pourtant on parle seulement 30 minutes par semaine. C’est à lui de se prendre en main. »
C’est dans ce travail continu, presque acharné, qu’il situe la différence entre les bons et les grands gardiens. Pour Ménard, tout part de là : « Tu peux être technique, mais si tu n’as pas l’enthousiasme, si tu n’es pas contagieux dans ton envie d’arrêter le palet, ça ne sert à rien. La technique, on peut l’expliquer. Mais si tu n’as pas de bras, pas de jambes, tu es fatigué après quatre minutes… ça ne donne rien. »
« Contagieux » : le mot revient souvent dans la bouche de Stéphane Ménard. Pas au sens médical, mais dans un sens le plus noble : celui qui inspire et entraîne les autres par attitude, car il est impossible d’être performant sans prendre du plaisir. Pour illustrer ce principe, il raconte une histoire saisissante « Un jour, une équipe de Ligue Nationale m’appelle en plein hiver. “Stéphane, on t’envoie un gardien. Il gagne des millions, mais ça ne va pas du tout. Tu es le seul capable de l’aider.” » L’homme arrive par avion en situation de burn-out. Ménard n’a que dix jours pour le remettre en selle. Et il commence par une leçon de vie. « À Montréal, il faisait froid ce jour-là. Je l’ai emmené sous un pont, avec des itinérants. Il y en avait un qui vivait dans une boîte en carton. Quand il s’est levé et qu’il a souri, je me suis tourné vers mon gardien et je lui ai dit :
“Toi, tu gagnes des millions et tu n’as plus le sourire. Lui, il n’a rien… et il sourit.”
Le choc est immédiat. « Ça l’a secoué. Ensuite, on a travaillé. C’était intense. » Ce travail a payé puisque le gardien a atteint la finale de la Coupe Stanley avec son club au printemps suivant.
Changer des vies par le hockey
Chez Stéphane Ménard, le hockey est aussi un vecteur des valeurs. « Le hockey, c’est un véhicule. » En substance, ce que le gardien apprend sur la glace — le goût du travail, le refus de l’abandon, le dépassement de soi — il peut ensuite le transposer dans sa vie personnelle ou professionnelle. « J’avais surtout des jeunes de 14-15 ans. Un jour, un adulte de 34 ans m’appelle : « J’aimerais suivre un stage comme les jeunes, même si je joue seulement en loisirs ». » C’était un cadre dirigeant, placé très haut dans la hiérarchie de son usine. Je lui dis : “Viens, on fait ce qu’il faut.” » Le stage dure cinq jours. Après deux journées intenses, l’homme craque : « Je vais mourir ma vie » (sic), mais Ménard le pousse à rester. « Les joueurs et les autres gardiens de but sont aussi allés le voir pour lui dire non, tu n’abandonnes pas. Il est resté toute la semaine. Il l’a fait. Et 3 jours après la fin du stage, j’apprends qu’il a lâché son travail à l’usine. Son travail qui lui rapportait peut-être 300 000 dollars par année… pour démarrer sa propre affaire. Et aujourd’hui, c’est une des grosses compagnies de paysagiste du Québec. Il donne des conférences et dit « Stéphane Ménard, il a changé ma vie ». En fait, je n’ai pas changé sa vie, je l’ai fait réaliser ce qu’il voulait vraiment faire. »
Un autre souvenir marquant concerne Marco Cousineau, un ancien choix de repêchage d’Anaheim (3e tour en 2008) que Ménard croise alors qu’il officie en LNAH aux Éperviers de Sorel-Tracy entre 2018 et 2022: « Il vient d’être échangé. Le coach Christian Deschênes le préviens : « pour ton premier entraînement avec Steph’ Ménard, ne mange pas » ». L’avertissement n’est pas de trop. « Je l’ai fait souffrir sa vie au premier entraînement (sic). Je l’ai fait vomir dans le coin de la Zamboni. Sa femme est venue à me traiter de malade, de fou. « Tu te fais souffrir, arrivé à la maison, il n’est plus capable de rien faire. Il est scrap. » (sic) ». Et pourtant, à l’issue de l’entraînement, Cousineau déclare à un journaliste « Si j’avais connu Stéphane Ménard à l’âge de 12 ans, je ne serais pas ici, je serais resté à Anaheim ». Ménard a remporté un championnat avec lui (en 2018-2019), admirant sa discipline : « Il faisait deux heures et demie de route pour venir pratiquer à 6h30 le matin. Je l’ai fait souffrir, mais j’ai gagné avec lui. »
Marc-André Fleury, l’élève devenu légende

Impossible de parler de Stéphane Ménard sans évoquer Marc-André Fleury. Leur histoire commence il y a plus de trente ans, alors que le petit gardien de Sorel n’a que 7 ans. « Ses parents sont venus à moi parce qu’ils voulaient que je l’amène à un plus haut niveau. Il y a eu des hauts et des bas, mais je l’ai entraîné jusqu’à ses 15-16 ans. Après ça, il s’est fait repêcher au premier tour. Quand même, premier choix ! Ça n’a pas été facile au début : il y avait des tests à passer avant la draft, et à 18 ans, avec tous les appels qu’il recevait, c’était beaucoup. Moi, je l’ai aidé à ramener les pieds sur terre. »
Avait-il rapidement vu son potentiel ? La réponse fuse. « Je le savais dès 12-13 ans. Marc-André, il est contagieux. Quand il sort une grosse mitaine (sic), le banc entier se met à vibrer. »
« Il reste humble. Il ne se plaint jamais. Sur la glace, si je ne lui dis pas de changer, il ne sort pas. Il reste là, jusqu’à la mort ! À dix ans, il dominait parce qu’il travaillait tout le temps, mais toujours avec le sourire. Il était contagieux. »
« Il sortait déjà des grosses mitaines (sic). Il était athlétique, il allait tellement vite. » Puis, dans un éclat de rire : « Il est même meilleur qu’à 20 ans… parce qu’il bouge moins, il est plus vieux ! Avec l’expérience et l’âge, son corps ne réagit plus de la même façon. Ça l’aide, il était presque trop rapide avant. »
Dans son bureau, Ménard conserve une relique précieuse : le chandail de la première Coupe Stanley remportée par Fleury, celui du match 7 marqué par un arrêt décisif – mais peu académique – du portier dans les derniers instants du match.
« J’ai toujours dit à mes gardiens : arrêtez le palet comme vous voulez, avec les dents s’il le faut, mais arrêtez-le pour gagner le match. ».
Cette finale 2009 reste gravée dans sa mémoire. « Je me rappelle très, très bien. C’était 2-0, puis en troisième période c’est revenu à 2-1. Mon téléphone sonnait sans arrêt : “Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui se passe ?” Je faisais les gestes avec lui. Quand la sirène a retenti, tout le monde est rentré chez moi en même temps. J’ai eu 92 personnes dans ma maison en dix secondes… dont une majorité que je ne connaissais même pas ! C’était fou. »
Aujourd’hui, même officiellement retraité, Fleury continue de susciter l’intérêt dans la LNH. « Il y a 8 ou 9 équipes qui veulent le sortir de la retraite. Pourquoi ? Il n’y a plus d’autres gardiens qui soient aussi contagieux que lui. Les autres gardiens sont tous les mêmes ». Va-t-il pour autant revenir sa décision ? Ménard, fidèle à sa discrétion, botte en touche : « Je ne suis pas dans le secret des dieux. C’est la première fois en 32 ans que je ne pratiquerai pas avec lui au mois d’août. Ça va faire drôle… mais je vais travailler avec Gabriel D’Aigle, cela va compenser. »
Gabriel D’Aigle, le successeur
Après avoir entraîné José Théodore et Marc-André Fleury, il se pourrait que Stéphane Ménard compte parmi ses protégés le futur des gardiens québécois en la personne de Gabriel D’Aigle. Le natif de Sorel, bientôt 19 ans, a déjà représenté le Canada au Mondial U18 en 2023 (avec une médaille de bronze) et vient d’être repêché par les Penguins de Pittsburgh au 3e tour (84e choix). Un signe du destin, puisque Fleury avait été choisi par la même franchise vingt ans plus tôt. « Il sort du lot. Il s’entraînait avec moi, puis il est rentré dans le système AAA. Il a bien fait sa place quand même. On se voit à l’été, on travaille bien et ensuite il a progressé. Il est déjà dominant. »
« Ça fait 5 ans qu’on s’entraîne avec lui et Marc-André Fleury » raconte Ménard. Ce dernier insiste sur le soutien que son illustre élève a apporté au jeune : « Marc-André a dit : “Gabriel vient s’entraîner avec moi, il est de Sorel comme moi”. C’est bien ce qu’il fait, il a investi pour lui. » Pour Ménard, aucun doute : D’Aigle a l’étoffe pour percer en LNH :
« C’est sûr (…) Pourquoi a-t-il été repêché ? Parce qu’il a une éthique de travail. Il n’abandonne jamais. C’est un guerrier. »
Attendu plus haut dans draft dès son arrivée avec les Tigres de Victoriaville en LHJMQ en 2022-2023, le portier a vu sa cote un peu baisser. « Quand il a débuté dans le junior majeur, il s’est mis à gagner tout de suite. Il a réalisé un jeu blanc pour son premier match. Ensuite ils l’ont mis sur le banc pour faire la place au gardien de 19 ou 20 ans [note : Nathan Darveau, de 3 ans l’ainé de D’Aigle, 1re équipe d’étoile de LHJMQ et meilleur gardien de tout le Junior Majeur cette année-là]. Je comprends, c’était une équipe de joueurs qui jouaient ensemble depuis longtemps. Ça a été un peu mal géré. »
Après deux années dans un rôle de substitut, Gabriel D’Aigle a pu enfin enfiler le rôle de titulaire, mais dans une équipe en reconstruction, qui a terminé avec le pire bilan de la ligue l’année passée (seulement 17 victoires en 64 rencontres). Ménard n’y va pas par quatre chemins pour qualifier la situation : « Ça été une grosse année de m****, appelons ça comme ça » tout en reconnaissant que cela va l’aider à forger : « Il faut que cela soit dur. Il a quand même travaillé fort. Mais au lieu de sortir en première ronde il est sorti en 3e. » Un mal pour un bien ? Peut-être, estime Ménard : « Ça lui enlève un peu de pression. Et il arrive dans une équipe, les Penguins, qui veulent reconstruire. En fait, il vit presque la même histoire que Fleury quand il est arrivé à Pittsburgh. »
Un franc-tireur face au système québécois
Avec la retraite de Marc-André Fleury et en attendant l’éclosion de Gabriel D’Aigle, force est de constater que les gardiens québécois sont devenus une espèce rare en NHL, alors même que la province a longtemps été une pépinière. Interrogé sur le sujet, Stéphane Ménard ne mâche pas ses mots.
D’abord, il pointe l’hypocrisie d’un règlement qui empêche les gardiens de faire appel à leur entraîneur personnel pendant la saison. « On se parle au cours de la saison. Malheureusement on est obligé de faire en cachette à cause du règlement du Junior Majeur. Le joueur ne peut pas sortir de sa ville ni parler avec un autre entraîneur. On a fait ça « old school, dans un vieux sous-sol, sur une piste synthétique, juste pour remettre les choses en place ». Comble de l’ironie « j’ai même eu un gardien qui s’était acheté un deuxième équipement pour venir travailler avec moi. »
Il dénonce aussi une rivalité stérile entre coachs :
« On n’a plus de gardiens parce que les entraîneurs se battent au lieu de s’entraider. On se nuit parce qu’on veut être la vedette. Moi, je m’en fous. Si quelqu’un m’amène une idée, j’en donne une autre. »
On comprend vite comment le système finit par tourner à l’entre-soi. Pas question, par exemple, pour un jeune gardien de travailler avec un entraîneur extérieur. « Mes jeunes, à un moment donné, je ne les vois plus. Ils vont dans de grosses structures AAA. Je dis aux parents : “L’année prochaine, on ne se parle plus, hein ?” Parce que les coachs leur disent clairement : “Si tu retournes avec Stéphane, c’est terminé. Tu ne joues plus pour nous. Même si tu es bon.” Et quand ils [les gardiens] sont dans le dur, les parents m’appellent. »
Enfin, Ménard fustige le système de sélection basé sur des bassins régionaux : « Un bassin peut avoir dix bons gardiens et n’en garder que deux. Les autres disparaissent. C’est fou. » Et plus largement, il s’inquiète du recul canadien dans la hiérarchie mondiale : « Avant, un gardien québécois se donnait à 200 %. Aujourd’hui, on n’a plus ce côté guerrier. Les Canadiens s’entraînent moins. Regardez Bobrovsky : il n’a jamais été repêché, mais il travaille plus et mieux que les autres. Est-ce que vous l’avez vu une seule fois avec la palette à l’envers, dans un match ou à l’entraînement ? Non. Tout est bien fait. »
La Ligue Nationale, un acte manqué
Qu’il ait formé des joueurs établis dans les plus grands championnats, on aurait pu croire que Stéphane Ménard trouverait naturellement sa place dans une organisation de NHL. Pourtant, il n’en a jamais été ainsi. La raison selon lui ? Sa personnalité, trop franche, trop entière pour les circuits institutionnels. « Je dérange. C’est compliqué pour un entraîneur de me contrôler », lâche-t-il.
Pourtant l’occasion de rejoindre la Grande Ligue s’est déjà présentée. François Beauchemin (encore un natif de Sorel-Tracy) qui évolue alors à Anaheim le contacte au mois de février 2007. « À ce moment-là, j’ai un travail qui ne me rapporte pas beaucoup mais que j’aime. À Anaheim il fait beau alors qu’à Québec il fait -30°C et c’est la tempête de neige. Beauchemin me dit :
“Stéphane ? C’est Franck. Je suis dans le bureau du coach, viendrais-tu nous aider ? On voudrait gagner la Coupe Stanley”.
« J’ai dit non. La famille… et la langue ne m’a pas aidé non plus. Je ne parle pas bien anglais. » Quelques mois plus tard, les Ducks remportent la Coupe Stanley. De quoi nourrir un regret ? « Ben oui je regrette…J’aurais pu travailler avec François Allaire [alors entraîneur des gardiens des Ducks] qui était très occupé (…). J’avais aussi appelé Marc-André pour lui demander son avis, il m’a dit “Tu n’as pas à faire ça, tu n’as pas le droit d’aller là”. Il n’était pas content (rires). Il ne voulait pas que je joue contre lui. »
Plus tard, il est de nouveau approché, cette fois à l’initiative même de Marc-André Fleury. « C’était lors de sa première année à Vegas. Il sentait que je pouvais peut-être y aller ».
« Mais non, ça faisait 30 ans que j’enseignais à mes gardiens de bien travailler, de faire preuve de respect. Je ne voyais pas dire aux 60 gardiens dont je m’occupe : “Demain je m’en vais pour coacher un seul gardien. Je ne vais penser qu’à moi, mon argent et je néglige tout le reste”. Je ne pouvais pas faire ça ».
Et en tant que Québécois, a-t-il été approché par le Canadien de Montréal ? « Non. Dans les années où Price n’allait pas bien on m’a souvent dit que j’étais peut-être le seul à pouvoir remettre Carey Price droit, à lui dire ses quatre vérités. (…) Carey Price, c’est vraiment un des meilleurs gardiens que j’ai vu. Il était exceptionnel dans la lecture du jeu»
Aujourd’hui, à 63 ans, Ménard garde pourtant la même énergie qu’à ses débuts. Stages, séances individuelles à travers le Québec, travail à distance en visio… Rien n’a changé. Sa philosophie reste intacte : pour lui, arrêter un palet n’est jamais une fin en soi. « L’histoire commence à chaque fois : avant, il n’y avait rien. Maintenant, on a une histoire à écrire. »
Illustrations par Manuel Gruson (instagram), Aline Clément et Emmanuel Giraudeaux
Notes : entretien réalisé par l’auteur, le 5 août 2025 à Meudon
L’homme qui murmurait à l’oreille de Marc-André Fleury
Portrait de Stéphane Ménard, entraîneur québécois atypique, mentor de gardiens et d’hommes.