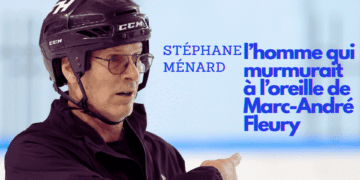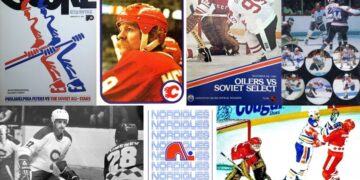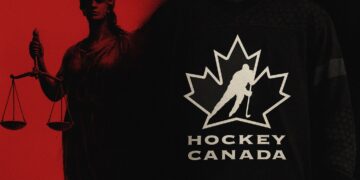Pourquoi ne réagit-on qu’après un drame ? Cette question sociologique ne sera pas abordée ici, elle pourrait nous éclairer face à bien des catastrophes notamment climatiques. L’autre question : pourquoi oublie-t-on si vite les drames, et les bonnes résolutions en même temps ? L’exemple d’Adam Johnson pourrait servir de modèle. Le hockeyeur américain ne sera peut-être pas mort pour rien. Le mieux eût été qu’il ne soit pas mort du tout.
Rappelons les faits. Samedi 28 octobre, lors d’un match de Challenge Cup britannique entre Sheffield et Nottingham samedi 28 octobre, Adam Johnson, passé par Pittsburgh en NHL, a été accidentellement blessé à la gorge par le patin d’un joueur renversé par une collision. Le jeu a été aussitôt arrêté et le personnel médical a procédé à son évacuation, mais il est décédé à l’hôpital pendant la nuit.
Cet accident très rare rappelait les cas de Clint Malarchuk (1,5 litres de sang perdu après une coupure de la carotide en 1989) et de Richard Zednik, qui avaient tous les deux survécu à des blessures choquantes de ce type en match de NHL. Le drame avait été évité ces fois-là, mais les accidents non mortels sont imputés à la fatalité.
Il faut – malheureusement – un décès pour qu’une prise de conscience ait lieu. C’est ce qui est arrivé en 1995 en Suède. Dans un match de pré-saison entre Mora et Brynäs, Bengt Åkerblom a eu la carotide ouverte par un patin et est décédé à l’hôpital, à 28 ans. Depuis ce jour, le protège-cou est obligatoire en Suède, mais la règle n’est pas toujours bien appliquée. Beaucoup de joueurs fixent mal cette protection, voire la coupent par des ciseaux, parce qu’ils la trouvent inconfortable, surtout avec la sueur, et ont une sensation de mal respirer. En 2020, l’international suédois Jonas Ahnelöv avait vu un coéquipier lui marcher dessus involontairement à l’entraînement et l’accident heureusement sans grosse conséquence avait fait débat. Des amendes avaient alors été infligées aux nombreux contrevenants.
Cette même saison 2020/21, le défenseur Moritz Seider – qui jouait en Suède à Rögle – avait été indemne lorsque, chutant sous les pieds de son adversaire, le protège-cou avait empêché le patin de s’enfoncer dans sa gorge. On se souvient moins de ces accidents qui n’ont pas eu lieu… Et pourtant, même Seider ne le porte pas depuis lors, ni en NHL ni en équipe d’Allemagne. Le mimétisme…

Depuis la mort d’Adam Johnson, la communauté du hockey a réagi. Partout dans le monde, les magasins d’équipement de hockey sont débordés par les demandes, les modèles recommandés sont en rupture de stock.
La fédération anglaise (EIHA) a annoncé qu’elle introduirait le protège-cou obligatoire à partir de l’an prochain. La ligue pro britannique, l’EIHL, où le drame mortel a eu lieu, s’est contentée de « fortement encourager » les hockeyeurs à le porter, mais sans le rendre obligatoire. Suivant la Suède et la Finlande où c’était déjà le cas, la Norvège a été le troisième pays à adopter l’obligation du protège-cou.
Au Canada, deux des trois ligues junior majeur avaient déjà l’obligation du protège-cou. Pas la WHL, la ligue de l’Ouest canadien, plus imprégnée de la vieille culture viriliste dédaignant toute protection, comme à une époque pour le casque, et comme dans le débat sur les visières, si longtemps pollué par le chroniqueur canadien si influent Don Cherry qui qualifiait ceux qui la portaient de « peureux » presque tous européens ou francophones. La visière n’a été rendue obligatoire qu’en 2021 en NHL – un an et demi après le renvoi de Cherry pour d’énièmes propos discriminatoires douteux – et uniquement pour les nouveaux joueurs intégrant la ligue. La WHL vient de rendre, à son tour, le protège-cou obligatoire.
En Allemagne – où Adam Johnson jouait la saison passée – sa mort a eu l’effet d’une traînée de poudre. La fédération de Basse-Saxe a été la première à le rendre obligatoire dans les championnats régionaux – y compris seniors – dès le 1er décembre. Le syndicat des joueurs professionnels a mené un sondage montrant que la majorité des hockeyeurs était favorable. Certains se sont aussitôt mis à le porter La DEL vient de suivre le mouvement en rendant l’équipement obligatoire au 1er janvier prochain. Et il ne s’agit pas d’un simple équipement, qui protège contre une crosse ou un palet mais n’est pas garanti contre les coupures, mais bien d’un protège-cou renforcé, composé d’une matière impossible à lacérer par un patin, norme européenne à l’appui.
Et en France ? Dans un communiqué paru la semaine dernière, la FFHG « encourage l’ensemble des pratiquants à le porter même quand ils sont dans une catégorie pour laquelle il n’y a pas de caractère obligatoire. Pour rappel, le port du protège-cou est obligatoire jusqu’à la catégorie U20. Des échanges sur ce sujet sont prévus très prochainement avec l’IIHF, les commissions sportives de la FFHG et les clubs pour envisager des évolutions réglementaires. »
Les protège-cou se sont déjà améliorés par rapport aux premiers modèles en plastique. L’innovation continuera sans doute si cet équipement devient indispensable. Rasmus Dahlin, qui a grandi avec en Suède mais l’a abandonné en NHL avant de le re-tester la semaine dernière, a déclaré au Times Herald de Buffalo : « J’ai essayé de le porter pendant un match, mais ça n’a pas duré si longtemps. Mais, bien sûr, je veux l’utiliser et je veux que quelqu’un développe un protège-cou agréable et respirant.
Laissons un dernier mot à cette proposition plus originale et plus cynique de l’expert de la télévision suédoise TV4 Fredrik Söderström, pour être sûr que la règle soit parfaitement appliquée sans que les joueurs ne trichent : « Faisons en sorte que le logo du sponsor principal soit sur le protège-cou. » Voilà une phrase qui pourra ouvrir un autre débat sociologique…