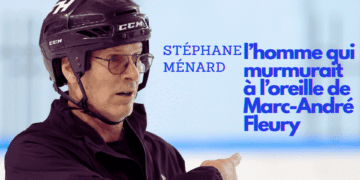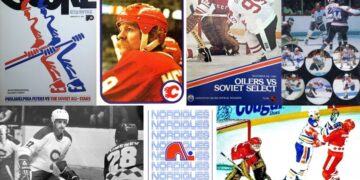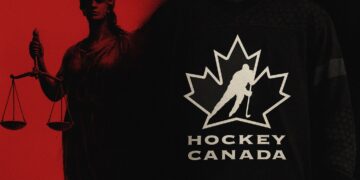Le hockey sur glace en Corée du Sud, né sous l’occupation japonaise avant la Seconde Guerre mondiale, est historiquement structuré autour des deux universités les plus prestigieuses du pays, Yonsei et la KU (pour Korea University, l’Université de Corée). Leur rivalité est largement inspirée de celle entre les institutions britanniques d’Oxford et Cambridge. Comme ces dernières, elles s’affrontent chaque année dans tous les sports, y compris le hockey sur glace. Si le match britannique a perdu de sa valeur dans le hockey anglais actuel professionnalisé, son homologue coréen est d’une importance vitale.
Comme une victoire en hockey sur glace compte autant que les autres sports dans la confrontation annuelle, chaque université tient à le gagner et prend donc très soin de recruter les meilleurs hockeyeurs de lycée du pays. De ce fait, Yonsei et la KU ont toujours entretenu leurs équipes de hockey. Le défaut est qu’elles sont un peu les seules. Les autres universités ne recrutent que « ce qui reste » parmi les hockeyeurs, et elles ne peuvent rivaliser.
De ce fait, le hockey universitaire coréen – et la totalité du hockey avant l’avènement d’une ligue professionnelle – se résume quasi-exclusivement à un affrontement entre ces deux équipes.
La saison universitaire débute en avril avec l’intégration des recrues et s’achève en février : c’est pourquoi le hockey coréen suit historiquement ce calendrier peu habituel.
Une rivalité qui remonte à loin
Entre Yonsei en bleu et la KU en rouge, la rivalité a toujours été extrême, et pas toujours animée du fair-play théorisé par les Anglais. Les polémiques y sont nombreuses depuis très longtemps. Et elles vont toujours dans le même sens : la KU se plaint d’un arbitrage biaisé en faveur de Yonsei et se fait sanctionner par des instances soupçonnées d’être toujours favorables aux bleus. Dès le championnat 1956 – sur le fleuve Han gelé – le scénario s’était produit car les (mauvais) perdants avaient endommagé le trophée pour gâcher la fête des vainqueurs ! Quand la KU avait de nouveau été autorisée à concourir en 1958, Yonsei avait déclaré forfait.
Dans ces années qui suivaient la guerre de Corée, le hockey se structurait entre les universités d’une part et les équipes militaires d’autre part (celles-ci ayant bénéficié de l’influence des soldats américains). Les casques bleus de l’ONU, chargés de veiller sur la zone démilitarisée autour du 38e parallèle qui sépare les deux Corées, ont même participé aux compétitions de hockey sur glace dans les années 1970.
Dans les années 1980, le championnat de Corée du Sud se disputait exclusivement entre cinq universités, lors d’un tournoi annuel.
L’arrivée des équipes d’entreprises
En 1994/95, une ligue de Corée du Sud est organisée à plein temps. C’est le moment où l’équipe d’une entreprise de construction (Seoktap) participe pour la première fois… et devient aussitôt championne ! Elle avait alors embauché comme entraîneur Josef Jandac, qui deviendra bien plus tard sélectionneur national de la Tchéquie, et qui était alors un jeune coach de 26 ans ayant ouvert une école de hockey en Corée
Les équipes corporatives – liées à une entreprise – recrutent évidemment des joueurs diplômés, plus expérimentés que ceux qui sont encore en université. Jusqu’alors, ceux-ci rangeaient les patins en entrant dans la vie professionnelle. En 1997/98, l’Asie et notamment la Corée est confrontée à une grave crise financière. Les équipes professionnelles risquent alors de toutes disparaître, mais l’homme qui passe à la tête du conglomérat Halla Group est le président de la filiale de climatiseurs Mando, où il avait créé une équipe de hockey sur glace : il la maintient en vie, et la finance dorénavant via le groupe. Halla – plus tard rebaptisé HL – est depuis lors la structure-phare du hockey en Corée du Sud.
Les conglomérats coréens (ces méga-entreprises multisectorielles aux nombreuses filiales) prennent alors le pouvoir. Le titre de champion passe à Hyundai Oilbank (la filiale pétrolière de la multinationale connue pour ses automobiles), puis à Dongwon (entreprise de vente de fruits de mer). Elles continuent d’affronter les universitaires et un terrible accident a lieu en 2002/03 quand un étudiant de Kwangwoon meurt en se couchant devant une tentative de tir.
L’investissement de Hyundai et de Dongwon est très éphémère. Il ne reste plus qu’une équipe pro (Halla) et les nombreux hockeyeurs sans équipe décident en 2003/04 de créer un club indépendant, qui ne serait adossé ni à une entreprise ni à une université. Ils s’entraînent autour de minuit, après leur journée de travail. L’initiative suscite la sympathie et on évoque un club citoyen (en quelque sorte avec des socios), mais le rêve reste sans lendemain.
Le projet olympique pour reconvertir une région minière
Un nouveau bouleversement arrive avec un financement parapublic, liée à la candidature de la ville de PyeongChang pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver. Elle est battue en 2003 par Vancouver pour l’organisation des JO 2010, mais s’active pour gagner la fois suivante (elle sera battue par la très dispendieuse candidature russe de Sotchi et attendra donc 8 ans de plus). Le pivot de cette transformation est la société Kangwon Land, filiale créée par le ministère de l’industrie et par la province de Gangwon pour reconvertir l’économie de la région vers les sports d’hiver – avec la création de la station de ski High1 – après la fermeture de ses mines de charbon.
Au même moment se crée la Ligue Asiatique, à laquelle participent Halla (qui joue à Anyang) et Kwangwon Land qui sera renommé High1 (et joue à Chuncheon, capitale provinciale du Gangwon). Ces deux équipes participent chaque année au tournoi pour le titre national, face aux universités.
La KU et Yonsei continuent de se crêper le chignon, la première proteste de nouveau contre l’arbitrage et se fait suspendre en 2004/05, puis en 2006/07 dès sa réintégration, avant de promettre solennellement en 2007/08 qu’elle ne contestera plus ! La hache de guerre n’est pas vraiment enterrée pour autant. Quand l’unique gardien de la KU se blesse en 2010/11, elle doit déclarer forfait car Yonsei refuse que lui soit accordé une dérogation d’aligner dans les cages un futur étudiant encore en lycée. Quand les rouges mettent fin à une série de 60 victoires de Yonsei en 2011/12, imaginez un peu combien ils savourent cette revanche !
L’armée se prend au(x) Jeu(x)
En 2013/14, de nouvelles équipes voient le jour : un club indépendant avec une multiplicité de petits sponsors (les Waves) et un club militaire (Sangmu) financé par l’armée qui entretient ainsi une équipe de hockey sur glace pendant que les joueurs font leur service militaire.
La structure Sangmu se distingue peu à peu entre une équipe de joueurs coréens en service militaire, qui ne joue que les compétitions nationales, et une équipe pro avec joueurs étrangers, les Daemyung Killer Whales : celle-ci devient championne en 2017/18 et porte en triomphe son célèbre nouveau coach, Kevin Constantine (sept ans après son passage à Angers).
Les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 auraient pu faire décoller le hockey en Corée du Sud, d’autant que l’équipe nationale a accédé à l’élite au même moment. C’est tout le contraire. Une fois l’échéance olympique passée, l’armée raye le hockey sur glace de son budget et re-transfère les fonds vers les deux grands sports, football et baseball.
Crises post-olympiques
Un an plus tard, Kangwon Land se retire à son tour, la fédération s’active pour faire survivre High1 mais voilà qu’arrive… le Covid-19. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que le président de la fédération est condamné en 2021/22 à de la prison ferme !
C’est la débandade. La saison 2022/23 s’achève par la dissolution de High1 – il ne reste donc plus qu’une seule équipe pro – tandis sur les quatre universités, une est en effectif ultra-réduit. En 2023/24, il est annoncé que c’est la dernière année que le hockey universitaire sera inscrit au programme du Festival des sports d’hiver.
Six ans après les JO, c’est donc la gueule de bois pour le hockey en Corée. Tous les efforts consentis pour préparer le rendez-vous olympique se sont arrêtés presque juste après, et la situation semble revenue vingt ans en arrière. Le retour d’une équipe de Corée du Sud dans l’élite paraît improbable dans ces conditions.
L’histoire complète du hockey sud-coréen saison par saison