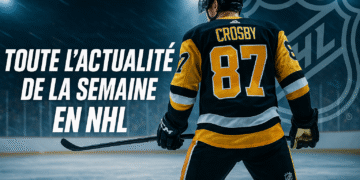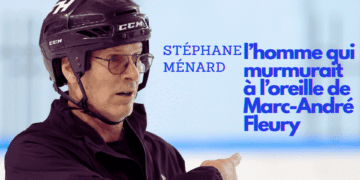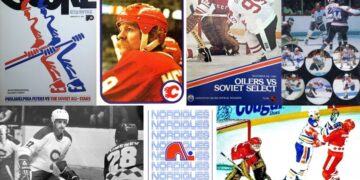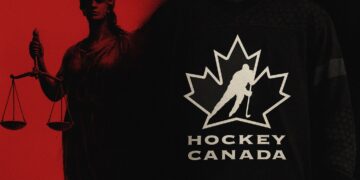À Brampton, l’organisation souhaitait un succès populaire. On s’y dirige. Une centaine de milliers de places ont été vendues en quelques semaines, et la finale est devenue à guichets fermés en l’espace d’un quart d’heure. On pourrait d’ailleurs regretter que l’IIHF n’offre qu’une arène de 5000 places pour sa finale féminine et qu’elle ne soit pas plus ambitieuse, quand on sait que cette saison les Américaines ont joué devant une foule record à Seattle de 14 551 spectateurs. L’impression que la fédération internationale est encore en sous-régime dans la valorisation du hockey féminin demeure flagrante. La communication a également fait défaut puisque l’on n’a connu le lieu et la date du Mondial féminin qu’à la mi-décembre. Pour un tournoi précédent en août, la programmation en avril a de quoi perturber. Vous le verrez dans cette présentation, le staff de la Hongrie a été pris au dépourvu.
Exemple de ce manque de communication, le point concernant la relégation. En 2019, les Bleues ont subi la double relégation avec la Suède en repartant en Division 1A. En marge de l’élargissement de l’élite de huit à dix nations, le souhait de l’IIHF était de rendre l’élite davantage accessible à d’autres équipes. En 2022, dans un contexte post-covid mais aussi avec l’exclusion de la Russie des compétitions internationales, l’IIHF décidait de ne reléguer qu’une équipe, ce fut (à une seconde près) le Danemark. Pour 2023, l’IIHF n’a fait aucune mention du système de relégation dans ses communiqués, le point n’est même pas mentionné dans le détail du format du tournoi. Ce flou provient probablement du fait que le Mondial D1A, initialement prévu en avril à Shenzhen, a été repoussé à une date ultérieure. La Chine est toujours dans une position délicate concernant le Covid avec la multiplicité des variants, et par voie de conséquence les restrictions se sont renforcées pour les voyageurs, rendant trop compliquée l’organisation d’une compétition sportive. Un revers majeur alors que l’IIHF s’est engagé à signer un accord historique avec la Chine en lui confiant l’organisation des trois prochains championnats du monde de la division inférieure, pour un montant de 3 millions d’euros pour chaque édition de la part de la fédération chinoise, dont une dotation de 100 000 euros pour chaque équipe participante. Au final, ce Mondial D1A se disputera en août… sans savoir pour autant combien d’équipes seront promues en élite.
Alors à défaut d’information, et plutôt que d’éviter une mauvaise surprise, la France (comme la Hongrie) partait sur l’hypothèse du retour de la double relégation, la formule d’avant Covid avec deux équipes reléguées qui est revenue comme une rumeur persistante. Les deux places éjectables synonymes de relégation seraient donc les deux dernières du groupe B, quand les trois autres (et c’est une certitude) se joindront aux quarts de finale avec les cinq meilleures équipes, toujours placées dans le groupe A.
Groupe B

À la suite d’un Mondial D1A d’Angers maîtrisé, avec un final en apothéose devant 3500 spectateurs dans une incroyable ferveur populaire jamais rencontrée dans l’hexagone pour les Bleues, l’équipe de France féminine est de retour pour la deuxième fois de son histoire en élite mondiale, quatre ans après Espoo 2019. Atteindre l’élite mondiale est une chose, pérenniser le bail parmi les meilleures en est une autre. Mais le retour des Bleues en élite coïncide avec le retour de la double relégation, c’est du moins la supposition qui a été faite. La mission maintien s’annonce d’autant plus ardue pour une sélection tricolore qui a amorcé un renouvellement historique de son alignement.
Huit joueuses (une gardienne, trois défenseures et quatre attaquantes), et non des moindres, ont fait leurs adieux à la sélection à Angers. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont pas les seules. L’attaquante Emmanuelle Passard, qui n’avait pas été appelée pour le sacre en D1A et dont un hommage a été rendu au tournoi d’Amiens cette saison, était membre des Tricolores depuis plus de dix ans. Passard a également raccroché après une belle carrière qui l’a emmenée de Montréal à Helsinki. Avec 65 réalisations, elle demeure d’ailleurs la meilleure buteuse de la (récente) histoire du HIFK féminin. Une dizaine de joueuses en moins en l’espace d’un an, c’est donc plus d’un tiers de l’équipe, autant dire que la transition paraît particulièrement délicate. Autant de départs pour une équipe promue en élite mondiale installe une problématique que l’équipe a tenté de gommer durant toute la saison, avec un important état des lieux opéré par le staff au fil des convocations.
Le poste de gardien constituait le premier chantier. Pendant près de dix ans, Caroline Baldin est demeurée au poste de titulaire, sa suprématie ne laissant que peu de place aux suppléantes. Caroline Lambert est la seule gardienne convoquée à avoir disputé un match en élite mondiale, la seule victoire d’ailleurs à ce niveau dans l’histoire de l’équipe de France féminine, face à l’Allemagne. Le rempart de 27 ans continue de bien performer avec Thurgovie, comptant plus de 80 matchs en élite suisse, mais aura-t-elle son mot à dire ? Lambert n’a disputé qu’un match et demi lors des tournois internationaux cette saison, quand Margaux Mameri, qui semble avoir la préférence du staff, en a disputé cinq. Le début de saison de la Francilienne de 25 ans semblait prometteur avec un contrat en Finlande, au HPK. Néanmoins, l’expérience a tourné court pour Mameri, deux matchs exactement, avec un poste de gardien obstrué, le retour au HPK du monument Noora Räty signant la fin du séjour finlandais. Margaux Mameri est finalement revenue en région parisienne, à Évry-Viry où elle a garni les rangs des équipes masculines, senior et U20. Ce changement de trajectoire en cours de saison sera-t-il suffisant pour demeurer compétitive devant la cage bleue ? L’incertitude plane mais sur les trois tournois internationaux, Mameri a conservé une moyenne honorable de 2,4 buts encaissés. Lambert a elle été titularisée contre le Japon dimanche en match préparatoire, une courte défaite qui l’a vue arrêter 28 des 30 tentatives japonaises. La première rencontre contre les redoutables finlandaises sera un bon indicateur. Justine Crousy-Théode, intégrée elle aussi à une équipe masculine, les Phénix de Reims, sera la troisième gardienne, sa première nomination à un championnat du monde.
Après le départ de Gwendoline Gendarme et Léa Parment ainsi que la grossesse de Léa Villiot, alliant toutes trois solidité, expérience et inspiration offensive, les lignes arrières constituaient l’autre chantier. Athéna Locatelli avait également fait ses adieux à Angers mais poursuivait sa carrière à Helsinki, ce qui malgré tout laissait une porte entrouverte. À quelques semaines du Mondial, le staff est finalement parvenu à faire ressortir « Loca » de sa retraite internationale alors qu’elle est toujours considérée, à 31 ans, comme l’une des meilleures arrières en Finlande. Elle a d’ailleurs amassé 29 points, le troisième meilleur total pour une défenseure et de loin le meilleur pointage de sa carrière. Elle a par ailleurs fini de la meilleure des manières sa dernière saison au HIFK en participant au premier titre de l’histoire du programme féminin initié en 2019 par le club d’Helsinki. La présence de Locatelli est un soulagement pour une défense française qui aurait subi un renouvellement trop brutal. Et cela change considérablement la donne. Capable de manger un long temps de jeu, n’hésitant pas à faire autorité devant son but mais avec une facilité à percer le rideau adverse, elle est plus que bienvenue.

Autre comeback, plus spectaculaire, celui concernant Sophie Leclerc. Maillon de l’équipe de France de 2012 à 2017, elle avait mis sa carrière en parenthèses pour se consacrer à ses études de médecine, désormais en huitième année. Après un break tout en continuant les entraînements, Leclerc est revenue, cinq ans plus tard (!), au tournoi d’Amiens en décembre… sous les yeux de son grand frère Nicolas, défenseur des Gothiques. Désireuse depuis un moment de retrouver les Bleues, elle ajoute un capital expérience précieux en défense. Même si ses premières apparitions en bleu ne datent que de la saison dernière, la Franco-canadienne Marie-Pierre Pélissou a désormais un statut de leader, en équipe de France comme en ligue suisse. Elle est suivie dans son sillage par de jeunes talents qui ont déjà percé en bleu, en premier lieu Lucie Quarto (20 ans), Louanne Mermier (22 ans), Mia Väänänen (23 ans). Mermier et Väänänen ont d’ailleurs plusieurs années canadiennes au compteur, un chemin qu’a rejoint Léa Berger. La voie de la transition a été empruntée alors que Raphaëlle Grenier, absente au Mondial d’Angers et lors des rassemblements durant toute la saison malgré une bonne saison au TPS Turku, n’a pas été retenue.
Côté offensif, la transition s’est faite plus naturellement. Julia Mesplède avait éclos au dernier tournoi de qualification olympique mais malheureusement, l’attaquante de l’Université du Vermont a vu sa saison ruinée par une grave blessure, ligaments croisés et ménisque. L’autre révélation du TQO Jade Barbirati sera bien là, elle a d’ailleurs terminé troisième meilleure marqueuse de la ligue collégiale québécoise avec 39 points en 28 matchs, en évoluant aux John Abbott College Islanders où sa coéquipière Manon Le Scodan a amassé un point par match. Lucie Turcotte, qui a été appelée cette saison après être passée sous les radars ces dernières années avant de connaître une très bonne première année en NCAA avec Stonehill College (16 points en 34 matchs), n’a en revanche pu atteindre la sélection, la faute à une forte concurrence dans un secteur bien garni, porté il est vrai par un trio magique.

Lorsque l’on évoque la NCAA et les Bleues, le nom de Chloé Aurard arrive tout de suite en tête. La native de Villard-de-Lans de 23 ans n’a plus rien à prouver, elle a connu cette saison la meilleure performance de sa carrière avec 54 points dont 20 buts en 38 rencontres. Sa cinquième saison avec Northeastern University, malgré une deuxième victoire au Beanpot, ne lui a malheureusement pas permis d’atteindre le championnat national. Une fin d’aventure en NCAA malheureuse qui l’a vue inscrire tout de même 204 points en 167 matchs de hockey universitaire. De son côté, Clara Rozier, sacrée avec Locatelli en Finlande, a souvent évolué entre l’étoile montante Julia Liikala et l’expérimentée Michaela Pejzlová à la saison stratosphérique. En bonne compagnie, la Morzinoise n’a jamais obtenu autant de points en Naisten Liiga finlandaise, 49 points dont 24 buts en 35 matchs, un sommet de carrière, ainsi que 6 buts / 13 points en 9 matchs de playoffs. Quant à Estelle Duvin, la centre numéro 1 des Bleues n’a eu aucune peine à s’acclimater au championnat suisse, avec 47 points en 23 matchs, le deuxième meilleur total en ligue suisse. Mais la fin de saison a eu un goût amer : son équipe a échoué à l’issue de la dernière manche en finale contre Zurich, en prolongation, alors qu’elle n’était pas alignée pour ce dernier match. Mauvaise nouvelle puisqu’une vilaine blessure la rend finalement très incertaine pour ce Mondial. Aura-t-on le trio magique Aurard – Duvin – Rozier, qui a enflammé la glace de l’IceParc lors de la dernière rencontre du mondial d’Angers ? Le doute est de mise, et Grégory Tarlé devra peut-être se passer de sa première centre capable de peser dans la balance dans les moments décisifs. Il pourra cependant compter sur Margot Desvignes, qui a relancé sa carrière en Suède, et les cadres Betty Jouanny et la capitaine Lore Baudrit, précieuses sur les unités spéciales et bien décidées à accompagner cette équipe jusqu’aux Jeux olympiques 2026 de Milan – Cortina.
Si le court terme nous amène à Brampton, nul doute que l’objectif olympique se dessine déjà sous nos yeux. Justine Crousy-Théode, Louanne Mermier, Léa Berger, Lisa Cedelle, Lucie Quarto, Anaé Simon, Emma Nonnenmacher, Jade Barbirati, Manon Le Scodan, Perrine Lavorel, Shana Casanova et Chloé Gentien ont toutes disputé au moins l’un des quatre derniers Mondiaux U18 et se retrouvent déjà en élite mondiale. Un nouveau cycle a déjà commencé avec en toile de fond le rêve olympique. Entre les revenantes en défense et ses stars offensives, les Bleues devront poursuivre leurs efforts de solidarité d’antan, mais l’acclimatation au plus haut niveau des nombreuses jeunes joueuses et leur capacité à assumer les responsabilités seront décisives dans un tournoi forcément exigeant et un tour préliminaire assez rapide (quatre matchs). Après deux matchs préparatoires rassurants (victoire contre l’Université de Toronto et courte défaite contre le Japon), les rencontres contre l’Allemagne et la Hongrie seront ciblées dans la course au maintien, les Bleues tenteront également de saisir leurs chances en privilégiant les contres contre la Finlande et la Suède alors que la jauge d’expérience s’enrichira au gré des matchs pour cette jeune troupe. À commencer par le premier, face aux Lionnes finlandaises.

Finlande
La France entrera dans le vif du sujet, c’est peu de le dire, pour le tout premier match de ce championnat du monde, le 5 avril face à la Finlande. Les Lionnes, les Naisleijonat, sont en quelque sorte l’invitée surprise de ce groupe B. Demi-finaliste systématique des Mondiaux depuis leur création en 1990 jusqu’en 2021, 13 fois médaillée de bronze et vice-championne du monde en 2019, la Finlande a été éliminée pour la première fois en quart de finale par la Tchéquie. La mauvaise passe dans sa zone de la pourtant exemplaire Jenni Hiirikoski sur la Tchèque Tejralová, qui a coûté le but éliminatoire en prolongation, a beaucoup affecté une équipe qui a peiné pour battre la Hongrie avant de s’incliner aux tirs au but face à des Japonaises – que la Finlande avait pourtant laminées 9-3 plus tôt dans le tournoi – lors des matchs de classement. Un dernier résultat lourd de conséquence avec cette sixième place sur ce Mondial 2022. La fédération finlandaise était toutefois persuadée, au sortir de la défaite contre le Japon, que son classement IIHF, troisième, lui permettait de rester dans le groupe A des cinq meilleures nations. Une interprétation erronée puisque l’IIHF a dû confirmer par un communiqué le glissement de la Finlande du groupe A au groupe B. Un choc pour une équipe habituée depuis des lustres à jouer les gros poissons, et qui se retrouve donc dans une configuration inédite.
Le mandat derrière le banc suomi de Juuso Toivola n’a donc pas commencé du bon pied. Si son prédécesseur Pasi Mustonen avait permis à la sélection de s’approcher des superpuissances nord-américaines, les mauvaises langues diront que le vestiaire a gagné en sérénité, les imbroglios à répétition entre Mustonen et la gardienne star Noora Räty ayant perturbé le groupe. Toivola avait succédé à Mustonen qui avait quitté le tournoi olympique de Pékin au lendemain du match inaugural pour raisons personnelles, alors que les deux hommes ont travaillé ensemble pendant huit ans. Toivola a souhaité installer une relation de confiance avec les joueuses, les résultats ont suivi jusqu’à ce revers choc aux dépens de la Tchéquie qui a changé la donne. Cela n’a pas empêché l’équipe de se retrouver dans le tumulte des histoires de couloirs, lorsque Susanna Tapani avait décidé, en plein championnat du monde, de s’éclipser de l’équipe pour assister au mariage d’un ami le temps d’un week-end. Une attitude inconcevable lorsque l’on participe à une compétition majeure, cela a en tout cas créé un tollé général en Finlande. Cet événement n’a-t-il pas fragilisé le groupe ? Même si l’intéressée s’était justifiée en précisant qu’elle avait eu l’accord du staff, l’évènement a définitivement écarté de l’équipe Tapani, si précieuse dans le slot.
Cette fragilité, les Finlandaises entendent la gommer, désormais sans Tapani et la marqueuse Michelle Karvinen. Les Naisleijonat veulent rectifier le tir et vite. Les trois tournois de l’Euro Hockey Tour auxquels elles ont participé ont fait office de parcours de santé. Face à la Suède, la Tchéquie, la Suisse ou l’Allemagne, elles ont remporté leurs 12 matchs avec seulement 11 buts encaissés et sont donc invaincues cette saison. Anni Keisala est toujours la titulaire au regard des trois derniers grands tournois, Mondiaux et Jeux olympiques, qu’elle a su négocier avec brio, même si elle a connu plus de bas que de hauts cette saison avec le HV71 en SDHL, qualifié de justesse pour les playoffs et rapidement éliminé en quart de finale. Si la chute du HV71 a été collective, Keisala n’a pas été en mesure de garder l’équipe à flot en quart, avec 11 buts en deux matchs. Sera-t-elle dans les meilleures dispositions ? Car la jeune Emilia Kyrkkö, meilleure gardienne du Mondial U18 en 2022, de solides performances en Finlande malgré une équipe de milieu de tableau et qui a joué les trois derniers matchs du tournoi de février dont deux blanchissages, reste en embuscade. D’ailleurs, souffrante, Keisala n’a rejoint que tardivement le groupe au Canada et sera incertaine face aux Bleues, ouvrant l’hypothèse Kyrkkö.
La profusion de jeunes talents ne laisse pas de place au relâchement. Les dernières bonnes performances au dernier Mondial U18, une élimination en prolongation en demi-finale face aux États-Unis, sont révélatrices de la bonne santé de la formation. L’entraîneure en chef Mira Kuisma des U18, les Tyttöleijonien, a rappelé qu’en dehors des objectifs liés au tournoi, la mission est de former dans les meilleures conditions les futures joueuses de l’équipe première. En Naisten Liiga, neuf des dix meilleures marqueuses finlandaises ont 23 ans ou moins, dont quatre qui ont 18 ans ou moins. Emilia Vesa et Julia Liikala du HIFK, Jenna Kaila et Jenna Hietala de KalPa ont réalisé la percée la plus spectaculaire mais ces deux dernières n’ont pas été retenues. Quant à Siiri Yrjölä (18 ans), Nelli Laitinen (20 ans) et Elisa Holopainen (21 ans), elles font figure de surdouées. Yrjölä, qui a joué la majorité de la saison en doublette avec Athéna Locatelli, a été l’arrière la plus productive de Liiga en terme de buts et de points mais elle a dû déclarer forfait, malade. Même son de cloche pour Holopainen, deuxième meilleure marqueuse de Naisten Liiga avec 75 points dont 41 buts en 28 matchs (soit une vingtaine de points (!) de plus par rapport à la saison précédente) mais blessée sérieusement puisqu’elle a dû subir une opération chirurgicale. Laitinen a connu un parcours identique la saison dernière à celui d’Yrjölä, et s’est parfaitement acclimatée à la NCAA en devenant une pièce maîtresse des Gophers du Minnesota, clairement une patronne en défense malgré son jeune âge.
Mais vous l’aurez compris, le talent, ce n’est pas ce qui manque à la Finlande. Le bloc de Luleå a tout d’un brûlot avec la paire défensive Jenni Hiirkoski (guerrière qu’une coupure au cou n’a pas freiné) – Ronja Savolainen et les attaquantes Viivi Vainikka, Petra Nieminen et Noora Tulus. Elles ont participé au troisième titre consécutif du LHF en SDHL suédoise. Tulus a d’ailleurs inscrit la bagatelle de 19 points en 12 matchs de l’Euro Hockey Tour, en plus d’atteindre pour la première fois le seuil des 50 points en SDHL. Quant à Petra Nieminen, c’est le cap des 30 buts (le plus haut total de la ligue cette saison) qu’elle a atteint. Le trio a inscrit un total de 38 points en 8 matchs de playoffs suédois. Un catalyseur et de nombreux jeunes talents qui gravitent autour doivent permettre à la Finlande de viser bien plus que la victoire de groupe. Autant dire que les Bleues seront dans la fosse aux lionnes dès le premier jour.

Hongrie
Au lendemain d’un premier combat face aux redoutables Finlandaises, la France affrontera un adversaire bien plus prenable et qui constituera un adversaire direct pour le maintien : la Hongrie. Pour autant, les Magyars vendront chèrement leur peau après avoir réalisé un bel exploit la saison dernière. Au Danemark, elles ne se sont pas contentées du maintien en élite puisqu’elles ont atteint les quarts de finale… pour le premier Mondial élite de leur histoire ! Au-delà du classement, et si l’on excepte deux lourdes défaites contre la Tchéquie et les États-Unis, ce qui a impressionné a été leur faculté à demeurer régulièrement dans le coup. Les Hongroises ont réussi à obtenir des points contre l’Allemagne et la Suède mais également à emmener la Finlande en prolongation en match de classement. L’équipe a fait preuve de beaucoup de solidarité mais elle a aussi réussi à produire du jeu offensif face à des adversaires présumés plus forts, un point très intéressant.
Ce parcours est donc devenu, de loin, le meilleur résultat de l’histoire de la sélection féminine de Hongrie qui était encore chapeautée par le sorcier Pat Cortina. Néanmoins, une incertitude entourait l’entraîneur québécois. La directrice de l’équipe féminine, Zsuzsanna Kolbenheyer, avait annoncé le 10 janvier que Cortina resterait à son poste mais sa présence en avril pour le Mondial était incertaine. La raison est que Cortina a un contrat en cours avec une équipe allemande de troisième division, le SC Riessersee de Garmisch-Partenkirchen. Tout dépendait si son équipe irait en playoffs d’Oberliga… et c’est le cas puisque son équipe a éliminé Hambourg au premier tour. Mais comment en est-on arrivé à cette situation ? L’annonce tardive du lieu et de la programmation du tournoi mi-décembre, alors qu’un nouveau mondial en août faisait partie des hypothèses, n’a pas permis à la fédération hongroise de s’organiser. Avec de bons résultats et un technicien apprécié, la fédération hongroise a souhaité privilégier la stabilité. L’ancienne joueuse Delanney Collins, déjà présente derrière le banc au tournoi d’Amiens, se tenait prête à veiller de nouveau sur l’équipe avec d’éventuelles directives à distance de Cortina si celui-ci devait être retenu en Allemagne. Finalement, l’entraîneur en chef de la Hongrie a bien pris le chemin de Brampton et lâché sa casquette bavaroise puisque le SC Riessersee n’a pas été en mesure d’inquiéter les Scorpions de Hanovre au second tour.
Si la France et la Hongrie ne se sont plus rencontrées en compétition officielle depuis le Mondial D1A de Vaujany, une victoire 2-1 pour les Tricolores, les deux nations se sont rencontrées régulièrement en matchs amicaux depuis 2019, malgré le covid. Neuf rencontres ces quatre dernières années, quatre victoires françaises et cinq hongroises, dont plus de la moitié des rencontres se sont achevées par un but d’écart. C’est dire la différence de niveau assez minime entre ces deux équipes déterminées à éviter les deux dernières places, cela promet une rencontre haletante.
Mais au contraire de la France, l’alignement hongrois, en pleine maturité, a été assez peu bouleversé avec un groupe homogène. Devant le but, Anikó Németh demeure une valeur sûre, la gardienne de 26 ans a montré qu’elle était un rempart dans les standards de l’élite mondiale. Németh est à son meilleur niveau, avec cette saison un pourcentage d’arrêts de 93,6% en EWHL. Sa sœur Bernadett est un pion essentiel comme le sont également la très offensive Franciska Kiss-Simon, ainsi que les naturalisées Taylor Baker et Sarah Knee, natives de Toronto et qui seront donc presque à la maison. Baker est une leader dans la nouvelle équipe PHF, la Force de Montréal, et Knee a terminé la saison à KalPa. Réka Dabasi, Alexandra Huszák et Fanni Garát-Gasparics sont toujours à la baguette en offensive, Gasparics a d’ailleurs réalisé, elle aussi, un saut convaincant en PHF, aux Metropolitan Riveters. Huszák, qui s’était cassé le poignet en février, s’est apparemment remise de cette blessure. Mira Seregély – un talent naissant en NCAA qui a fini meilleur marqueuse de l’Université du Maine – Emma Kreisz, Hayley Williams et Enikő Tóth sont autant de maillons importants d’un groupe finalement homogène.

Allemagne
Trois jours plus tard et quelque peu ménagées, les Bleues auront rendez-vous le 9 avril pour un autre match déterminant, l’Allemagne. Absentes des deux derniers tournois olympiques, les Allemandes savent pertinemment qu’elles reviennent de loin, leur place en élite ne se jouant qu’à un dixième de seconde et un but gagnant de Tanja Eisenschmid. Ce but a permis un maintien inespéré… et la relégation du Danemark. Mais il traduit aussi une réelle perte de vitesse dont elles ne sauraient se satisfaire. Pour autant, la fédération allemande entend renforcer le secteur féminin. Penny, une chaîne de supermarchés qui est le sponsor de l’équipe masculine depuis plusieurs années, a par exemple décidé de soutenir la sélection féminine par souci d’équité. Une bonne nouvelle, symbolique, mais qui ne révolutionne pas encore l’équipe féminine. Les U18 font l’ascenseur depuis quelques années, et la sélection senior n’est pas bien loin d’en faire de même. Thomas Schädler, qui sera derrière le banc de l’Allemagne pour un troisième championnat du monde, est d’ailleurs également adjoint de Franziska Busch pour l’équipe U18. Trouver une certaine synergie entre les deux sélections et installer le meilleur tremplin possible pour les plus jeunes forment un objectif dont s’est emparé Schädler. Mais la principale problématique, c’est que la majorité des joueuses peinent à s’exporter et sont pour la plupart issues de la Frauen Bundesliga, rebaptisée depuis peu DFEL pour se calquer sur la DEL masculine. Le niveau de la DFEL est insuffisant pour le moment pour concourir au plus haut niveau international, c’était en tout cas l’avertissement de la capitaine Daria Gleissner à l’automne dans les colonnes de l’Allgäuer Zeitung.
Ce manque de compétitivité a particulièrement été flagrant cette saison. L’exclusion de la Russie des compétitions internationales a permis à l’équipe d’Allemagne d’intégrer l’Euro Hockey Tour féminin. Cela lui a permis de se mesurer à des équipes du groupe A, Suisse et Tchéquie, et deux nations qui lorgnent dessus, la Finlande et la Suède. Les résultats se sont avérés catastrophiques pour les Allemandes : 4 buts marqués pour 47 encaissés en 11 matchs et autant de défaites. À leur décharge, cela aura permis de s’exposer de manière constante au niveau de l’élite mondiale, mais qui est bien loin du niveau que côtoient la majorité des joueuses.
Plusieurs gardiennes ont été testées durant la saison mais deux noms ressortaient du chapeau, Franziska Albl et Sandra Abstreiter, respectivement 27 et 24 ans et qui se sont partagées la tâche au Mondial 2022. Albl évolue dans le championnat allemand féminin mais l’entraîneur en chef actuel, Thomas Schädler, a convaincu l’équipe masculine des Hammer Eisbären en Oberliga de la prendre sous son aile pour les entraînements. Elle évolue donc principalement en ligue féminine mais elle a joué dans cinq équipes masculines de Bavière durant sa carrière. Depuis 2017, Albl est militaire sportive dans la Bundeswehr, l’armée nationale, une voie qui permet de pratiquer le hockey de manière semi-professionnelle avec un temps aménagé. Malheureusement pour elle, Albl n’a pas été retenue. Sandra Abstreiter joue elle à un niveau plus compétitif, en NCAA, où elle a réalisé de solides performances avec Providence College ces quatre dernières années. Abstreiter voit donc le poste de titulaire lui tendre les bras, alors que les deux autres gardiennes disputeront leur premier Mondial.
Coup dur en défense et bien au-delà tant elle a une influence sur le jeu et sur les résultats (jusqu’à la dernière seconde), la meilleure marqueuse et l’héroïne de 2022 Tanja Eisenschmid a renoncé aux Mondiaux car elle se sentait dans une forme insuffisante. La défenseure de 29 ans, qui a évolué à Djurgården cette saison, va manquer considérablement dans une arrière-garde que domineront Daria Gleissner et les deux nouvelles leaders en défense, Tabea Botthof et Nina Jobst-Smith. Quant au secteur offensif, il pose aussi beaucoup d’interrogations. Longtemps incertaine avec une blessure qui avait refait surface, la centre numéro 1 Laura Kluge, qui a disputé six championnats du monde et qui avait inscrit 4 points en 4 matchs lors de la dernière édition au Danemark, est bel et bien présente. Les espoirs reposent essentiellement sur elle ainsi que sur les jumelles Welcke, Lilli et Luisa, 20 ans, qui jouent ensemble à l’Université du Maine en NCAA… et qui ont d’ailleurs toujours joué ensemble. À elles deux, « Li » et « Lu » Welcke ont amassé 43 points en 33 matchs. Déjà présentes au Mondial 2022, elles devront confirmer mais elles devront aussi être soutenues pour ne pas devoir sauver leur peau à la dernière seconde, comme au Danemark.
Suède
Après des années sombres et une relégation en 2019 – qu’elle n’a pas honorée en raison de l’exclusion de la Russie – la Suède a redressé la tête avec une septième place et une belle résistance (0-3) contre le Canada en quart de finale.
L’épanouissement du hockey féminin ne se limite évidemment pas à l’équipe nationale. En retard par rapport à sa voisine finlandaise, l’accessibilité aux jeunes filles a été améliorée. L’entraîneur national Arvid Lundberg confiait à HockeySverige « qu’il s’était passé plus de choses au cours des trois dernières années qu’au cours des quinze précédentes ». La relégation a probablement permis de prendre la mesure de la trop grande négligence du hockey féminin en Suède. Résultat en mettant en route une vraie politique de développement : augmentation de 39% pour les joueuses de 0 à 9 ans, et +30% pour les joueuses de 10 à 20 ans. Cette ouverture aux jeunes talents s’accompagne d’une amélioration de la détection. La fédération a d’ailleurs lancé le programme Olympisk Offensiv, « l’offensive olympique » destinée à détecter, développer et accompagner les meilleures joueuses de 16 à 19 ans. Cet objectif olympique est particulièrement ambitieux puisque les Suédois ont pour souhait d’être médaillés aux Jeux olympiques 2026 et 2030, un objectif finalement plus en phase avec la renommée de cette grande nation de hockey.
Autre mesure qui est par contre d’intérêt général pour les autres nations : la légalisation des mises en échec. Une disposition inédite alors que toutes les charges sont interdites par l’IIHF, même si l’intensité est parfois ajustée en fonction du jeu, notamment en Amérique du Nord. Ce projet pilote initié par la fédération suédoise, qui concerne les deux ligues principales du pays, la SDHL et la NDHL dès cette saison 2022-23, a permis de clarifier la limite entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. En introduisant les mises en échec, la fédération estime que cela permettra de réduire les blessures à la tête. On part du principe que cela permet, comme chez les garçons, de s’obliger à garder les yeux levés et ainsi améliorer l’anticipation. Après cette première saison d’expérimentation, le changement est une réussite. Les blessures n’ont pas explosé, bien au contraire, et les premières intéressées en sont ravies. 345 joueuses de SDHL et NDHL ont répondu à une enquête, 86,4% jugent positive l’introduction des mises en échec. De l’aveu des suiveurs de la SDHL, la refonte des règles a permis d’augmenter l’intensité et la rapidité. Le coach Lundberg, qui y voit un changement de règle servant le développement de l’équipe nationale, est plus que convaincu, il constate une prise de décision plus rapide et estime que le niveau de concurrence ne sera que plus élevé.
La branche féminine du hockey suédois est donc, enfin, dans la bonne direction. Longtemps pointée du doigt pour sa forte proportion de joueuses étrangères, la SDHL est en passe de limiter progressivement cette internationalisation en favorisant les hockeyeuses locales. Dans le même temps, l’équipe U18 a réalisé un remarquable parcours au dernier Mondial en atteignant la finale. Toutes deux au HV71, Hilda Svensson et Mira Jungåker, 17 ans ou presque, ont été probablement les deux grandes révélations de l’équipe. Svensson a été cette saison la meilleure marqueuse chez les juniors en SDHL avec 22 points. Jungåker, qui a acquis un spot prépondérant dans la brigade défensive du HV71, a la particularité d’avoir obtenu le même nombre de points (5) en l’espace de quelques mois entre le Mondial élite, déjà à son aise en 2022 malgré son jeune âge, et le Mondial U18 où elle fut élue meilleure arrière de la compétition.
Une vraie nouvelle génération forte de 20 à 22 ans s’est créée dans la « Damrkonorna » avec Maja Nylén Persson (pour la deuxième fois de suite meilleure buteuse et marqueuse chez les défenseures en SDHL), Hanna Thuvik, Lina Ljungblom et Josefin Bouveng en tête de liste. Âgée de 25 ans, Sara Hjalmarsson a été la révélation de Providence College cette saison. Hjalmarsson, qui avait privé les Bleues de Jeux olympiques par son but gagnant au TQO, est à la fois redoutable devant le but (quatrième meilleure buteuse NCAA avec 24 réalisations) que solidaire dans son camp (élue meilleure attaquante défensive NCAA). La Suède était également bien représentée devant les poteaux en NCAA avec Emma Söderberg mais aussi Tindra Holm, avec chacune un pourcentage d’arrêts proche des 94%. Il était prévu que Söderberg reste titulaire, au regard d’une plus grande expérience. La gardienne de 25 ans, qui a atteint cette saison un record de blanchissages dans l’histoire de l’Université de Minnesota-Duluth, avait confié aux médias suédois avoir très mal vécu la déroute de la Damkronorna en quart de finale des JO de Pékin, surclassée 11-0 par les Canadiennes. Sept mois plus tard au Mondial 2022, elle a permis à son équipe de faire douter le géant canadien au même stade de la compétition, en réalisant 54 arrêts et une défaite honorable de 3-0.
Söderberg titulaire ? C’était sans compter sur le retour de l’emblématique Sara Grahn, qui n’avait pas été appelée pendant plusieurs années, son dernier championnat du monde datant de 2019… et qui n’avait jusqu’à maintenant presque eu aucun contact avec le sélectionneur Lundberg. C’est pourquoi elle s’est dit « choquée » quand elle a appris sa sélection. Le retour de la gardienne de 34 ans, une énième fois derrière le sacre de Luleå, en a surpris plus d’un. En revanche, les absences de Jessica Adolfsson, Thea Johansson et Emma Nordin ont également de quoi surprendre. L’icône Nordin, quatre participations aux Jeux olympiques et six championnats du monde à son actif, penchait vers une retraite internationale, sa dernière compétition datant du tournoi olympique de Pékin. Elle jugeait son état de forme insuffisant. Avant chaque regroupement de la saison, Arvid Lundberg a tenté de convaincre Nordin, 31 ans, qui n’a cessé de refuser. Ses 36 points, 17 buts et 19 passes, en SDHL lui ont permis de devenir la Suédoise la plus productive du championnat et de retrouver une pleine confiance… mais elle n’a pas été invitée pour ce Mondial ! A-t-elle fait les frais de ses précédents refus ? En tout cas, la Damkronorna a une nouvelle génération talentueuse et peut toujours compter sur ses leaders, Hanna Olsson et Felizia Wikner Zienkiewicz. Avant Grahn, Fanny Rask a réalisé un retour remarqué en sélection cette saison alors qu’elle avait mis temporairement un terme à sa carrière en 2020, elle est dans le top 10 des meilleures marqueuses de l’histoire de la SDHL. Le 11 avril pour leur dernier match de groupe, les Bleues s’attaqueront à cette équipe de Suède plus sereine et ambitieuse.
Le programme des Bleues :
Groupe A

Japon
Le Mondial élite féminin est, depuis de nombreuses années, divisé en deux groupes de niveau, et l’accession au groupe A, qui regroupe les cinq meilleures nations, était un objectif affiché par des équipes plus ambitieuses. L’exclusion de la Russie, pensionnaire du groupe A avant le conflit en Ukraine, a permis d’offrir une lutte plus ouverte. L’entraîneur national nippon Yuji Iizuka avait un programme qui visait à intégrer le groupe A, ce fut chose faite à l’issue des Mondiaux 2021. En 2022, pour la première fois de son histoire, « Smile Japan » comme on la surnomme s’est donc retrouvée parmi les meilleures, et l’acclimatation a été sans surprise particulièrement difficile. Le Japon a subi quatre défaites, ne marquant que 4 buts pour 31 encaissés. Mais les Japonaises se sont par la suite révélées redoutables, ne cédant qu’aux tirs au but en quart de finale contre la Suisse, avant de déjouer la Suède 5-4 lors du premier match de classement. Elles ont ensuite livré une nouvelle bataille lors du deuxième, contre la Finlande, n’encaissant aucun but et ne faisant la différence qu’en fusillade.
Cette ultime victoire du Japon face aux favorites finlandaises, qui avaient humilié les Nippones 9-3 en match de poule, a permis de prolonger le bail dans le groupe A et de signer une cinquième place à l’issue de ce Mondial 2022, la meilleure performance de l’histoire de l’équipe féminine du Japon. Une performance saluée à l’occasion de la cérémonie du prestigieux trophée des sports du Japon, dont la 71e édition a été décernée aux hockeyeuses. Une sacrée reconnaissance pour le hockey féminin. La capitaine Shiori Koike, montée sur scène pour recevoir cet illustre prix, a témoigné de l’important soutien des sponsors et des efforts de la fédération. Cette distinction a permis aussi d’obtenir une subvention de la part du Conseil des sports du Japon, destinée à « améliorer la compétitivité ». L’équipe du Japon, parfois isolée pour sa préparation, en a alors profité pour réaliser une tournée en Europe. Les Japonaises sont notamment passées par la France, battant les Bleues lors d’un match improvisé à Louviers (2-1 en prolongation) puis au tournoi d’Amiens (4-1).
Longtemps dépendant des performances devant le but de Nana Fujimoto, dont le mandat a duré de 2006 jusqu’aux JO 2022, le Japon s’est trouvé une digne héritière en la personne de Miyuu Masuhara. Âgée de 21 ans, la petite (157cm) gardienne a réalisé deux derniers matchs absolument éblouissants au Mondial 2022, stoppant 22 des 23 lancers suisses en quart de finale, avant de réaliser un incroyable blanchissage contre la Finlande avec 61 arrêts et une série victorieuse en fusillade. Alors que l’on pouvait craindre que la retraite de Fujimoto laisserait un immense vide, la relève est déjà là, le Japon disposant de jeunes espoirs talentueux devant le but. Outre Masuhara, signalons que Riko Kawaguchi (déjà présente au dernier championnat du monde) et Ririna Takenaka se sont partagées le travail lors du dernier Mondial U18 D1A, le tournoi le plus maîtrisé de l’histoire pour cette catégorie d’âge puisqu’elles n’ont encaissé aucun but en quatre matchs, alors que l’équipe a inscrit 26 buts. Kiku Kobayashi, testée cette saison avec succès en équipe première, avait, en 2020, enregistré 2 blanchissages en 2 matchs au Mondial U18, elle a été préférée à Takenaka. Miyuu Masuhara devrait partir titulaire, même si Kawaguchi a connu de bons matchs de préparation, blanchissant notamment en février la Slovaquie du phénomène Nela Lopušanová.
L’équipe féminine a réussi ce que l’équipe masculine a été incapable de faire : créer un vivier avec des joueuses qui peuvent rapidement performer au plus haut niveau, et ce malgré l’isolement géographique et les difficultés à exporter les talents. Mais la porte est désormais plus ouverte pour certaines qui peuvent tenir des premiers rôles. C’est le cas des sœurs Toko, la défenseure Ayaka (désormais nommée Hitosato car mariée l’année dernière) et l’attaquante Haruka, que connaît très bien la capitaine des Bleues Lore Baudrit puisqu’elle évolue à leurs côtés à Linköping. Elles ont toutes deux réalisé une première saison SDHL impressionnante en devenant des références à leur poste. D’autres sœurs, Akane et Aoi Shiga, forment la colonne vertébrale de cette équipe du Japon, avec la vétéran Akane Hosoyamada. Akane Shiga avait d’ailleurs inscrit 3 buts en 4 matchs au Mondial 2022. Absente de ce tournoi, Rui Ukita a réalisé un retour en forme cette saison, avec notamment 6 buts et 3 assistances au tournoi de Budapest de février, Haruka Toko enregistrant 2 buts et 9 passes. Ukita est bien de retour dans l’alignement pour ce championnat du monde. Et parmi les plus jeunes, une pépite se détache : Makoto Ito, qui n’est pas que le personnage du manga School Days mais également une hockeyeuse prometteuse. A seulement 18 ans, elle a déjà pris ses marques dans le hockey international, meilleure marqueuse des Jeux olympiques de la Jeunesse en 2020, 7 points en 4 matchs au Mondial U18 et 4 points à son premier Mondial en 2022. Et Ito a d’ailleurs marqué le but gagnant du Japon en match préparatoire dimanche contre la France. Une nouvelle preuve que le Japon (22 ans de moyenne d’âge pour ce tournoi), malgré les retraites des icônes Nana Fujimoto, Chiho Osawa ou Hanae Kubo, sait se renouveler, et se prend à rêver d’une médaille, objectif impensable il y a encore quelques années.

Suisse
Quatrième lors des deux derniers championnats du monde ainsi qu’aux Jeux olympiques de Pékin, la Suisse connaît une certaine stabilité, même si cela signifie trois échecs consécutifs pour le match de la médaille de bronze. À la décharge des Helvètes, le dernier championnat du monde au Danemark a été émaillé de cas de Covid et donc de tracas durant toute la compétition. En tout cas, la médaille est l’objectif clairement affiché de la « Frauen Nati » et de son entraîneur Colin Muller, avec un alignement qui compte une moitié de joueuses expatriées alors que le championnat national souffre encore de la comparaison avec d’autres pays. Les clubs sont moins structurés qu’en Suède ou en Finlande, ce qui ne manque pas d’alimenter le débat, certaines joueuses n’hésitant pas à mettre en lumière le retard de la « Women’s League » (ou SWHL, c’est selon) alors que la National League masculine est toujours plus rutilante. L’ambitieux projet de Zoug, porté par l’ex-joueuse et coach de la Nati Daniela Diaz, cultive malgré tout l’espoir d’une nouvelle ère pour le championnat féminin en Suisse. Un espoir qui s’est aussi renforcé par la prise de fonction de l’ancienne joueuse Kathrin Lehmann qui, à 42 ans, est devenue la première femme à siéger au conseil d’administration de la fédération suisse de hockey.
La Suisse dispose d’un solide duo de gardiennes avec Saskia Maurer et Andrea Brändli, qui évoluent toutes deux sur le circuit universitaire NCAA et qui ont été concurrentes sur le poste de titulaire ces deux dernières années. Brändli, qui a quatre ans de plus que Maurer, a néanmoins acquis la préférence du staff sur les deux dernières compétitions. Brändli a connu un changement important en passant d’Ohio State University à Boston University. Pour autant, elle n’a pas été perturbée puisqu’elle a conservé des statistiques flatteuses, 92,8% d’arrêts.
On pensait la carrière internationale de Sarah Forster terminée, mais Muller a finalement rappelé la défenseure aux 207 sélections. La Jurassienne de 29 ans, qui a disputé cinq saisons en Suède durant sa carrière, a pris un virage à 180 degrés en prenant le choix audacieux de traverser l’Atlantique. Un choix finalement judicieux puisque, dès ses premiers coups de patin en Amérique du Nord, Forster est devenue une leader en PHF avec son équipe des Metropolitan Riveters, et elle a accepté de revenir dans l’équipe à la croix blanche après un an d’absence. Son retour est une aubaine dans une défense qui a encore beaucoup à prouver.
En attaque, Lara Stalder affole toujours les compteurs en devenant pour la quatrième fois (!) meilleure marqueuse de la SDHL suédoise, même si elle a amassé 28 points de moins que la saison précédente qui, il est vrai, l’avait vu décrocher un record de pointage en élite suédoise. Si elle s’est avérée discrète en finale suédoise, muselée par Luleå, Stalder demeure, à 28 ans, l’arme fatale de cette équipe de Suisse. Mais les regards seront avant tout portés sur Alina Müller qui a connu une saison totalement folle en NCAA à Northeastern University, aux côtés de Chloé Aurard. Müller a connu une saison de 60 points, le deuxième meilleur total du championnat universitaire, 27 buts et 33 passes. Cette folle saison lui a permis de passer le cap des 250 points et de décrocher par la même occasion un record en devenant la joueuse la plus prolifique de l’histoire de Northeastern, dépassant la superstar américaine Kendall Coyne Schofield. « Money Mueller » comme on la surnomme du côté de Boston est souvent décisive et peut réellement créer la différence à chaque match. Si elle est devenue probablement l’une des meilleures joueuses de centre au monde, Müller sera également revancharde puisqu’une blessure au genou au Mondial 2021 et le Covid au Mondial 2022 (comme Stalder) ont écourté ses tournois.
Deux joueuses historiques ont décidé de quitter la sélection nationale, Dominique Rüegg et Evelina Raselli, alors que Phoebe Stänz a décidé de faire un break. Les seconds couteaux, comme Noemi Ryhner, Laura Zimmermann, Sinja Leemann ou Alina Marti, devront donc prendre le relais alors que des nations concurrentes, particulièrement dans ce groupe A, ont gagné en profondeur de banc.

Tchéquie
De la profondeur, la Tchéquie peut se targuer d’en avoir alors que les sections féminines de tous âges ont connu une année exceptionnelle. À l’occasion du Festival olympique de la jeunesse européenne 2023, l’équipe U16 a remporté la médaille d’or du tournoi, le coach Jan Lucák poussant son escouade à battre en finale la Slovaquie… entraînée par sa femme, Nicol Lucák Čupková ! Rares sont les situations où les deux conjoints se retrouvent derrière un banc adverse ! Durant la compétition précédente, c’est la section U17 qui s’était emparée de la médaille d’or, aux dépens de la Suède. Côté U18, la Tchéquie a encore une fois surclassé son groupe mais elle a échoué de peu (1-2) en quart de finale contre les Suédoises. Enfin concernant l’équipe première, elle a disputé pour la première fois de son histoire les Jeux olympiques, tombée avec les honneurs en quart de finale contre les États-Unis (1-4). Au Mondial 2022, elles sont parvenues à passer ce fameux cap : confirmer l’énième survol du groupe B pour intégrer le groupe A, si proche ces dernières années. Après s’être inclinées d’un but en quart de finale contre la Finlande en 2021, les Tchèques ont pris leur revanche en prolongation, avant d’aller chercher la première médaille, en bronze, de leur histoire. Quelle année pour le hockey féminin tchèque en 2022 !
Un premier tournoi olympique et une première médaille dans l’histoire de l’équipe féminine tchèque ont marqué un début retentissant de la nouvelle manager de la sélection, Tereza Sadilová. Elle avait fait le pari d’embaucher une personnalité forte, la Canadienne Carla MacLeod, finalement totalement adoptée par les joueuses et toujours derrière le banc tchèque, après avoir succédé à Tomáš Pacina après les Jeux olympiques. Rappelons que celui-ci avait démissionné pour raisons de santé après deux années au poste d’entraîneur. Le style de MacLeod est finalement peu différent par rapport à son prédécesseur dans les grandes lignes, si ce n’est qu’il y a davantage de pression devant le but et que la vitesse d’exécution est plus rapide. La Tchéquie peut se le permettre car la sélection féminine sait désormais se renouveler et fabriquer des talents d’exception qui ne sont plus seulement l’œuvre de l’Amérique du Nord. Adéla Šapovalivová est en tête de liste, elle a bientôt 17 ans mais elle compte déjà 10 points dont 7 buts en deux éditions de championnat du monde senior. Toujours éligible en U18, elle a épaté la galerie avec ses 4 buts en 5 matchs au dernier Mondial U18, dont le but le plus rapide de l’histoire du tournoi en 10 secondes. Une fois de plus, Šapovalivová devrait être l’une des attractions d’une équipe qui a gagné davantage en popularité dans son pays. Tereza Plosová n’a que quelques mois d’écart avec Šapovalivová mais elle a, elle aussi, déjà tout d’une grande. Hormis ses 6 points au dernier Mondial U18, Plosová a été convoquée pour la première fois en senior au tournoi de Füssen en février, la novice de 16 ans a mené les compteurs de son équipe avec 3 buts et 2 passes, et MacLeod l’a invitée pour ce championnat du monde.
Šapovalivová et Plosová mais aussi Tereza Pištěková, Daniela Pejsová ou Natálie Mlýnková sont autant de talents qui ont permis à la Tchéquie de gagner en standing, et d’attirer la curiosité. Mlýnková était d’ailleurs l’une des meilleures attaquantes européennes en NCAA cette saison avec 42 points en 36 matchs, huitième meilleure buteuse du circuit universitaire avec ses 23 buts pour l’Université du Vermont. De jeunes talents ne cessent de percer, et la Tchéquie compte toujours dans le même temps sur ses joueuses stars. Michaela Pejzlová a réalisé une saison explosive au HIFK avec 82 points (32+50) en saison régulière, 40 points de plus que sa saison précédente (!) et la troisième meilleure performance de l’histoire du championnat élite finlandais. La Française Clara Rozier, souvent alignée à ses côtés au HIFK en première ligne, a dû apprécier. Pejzlová, qui a également amassé 24 points en 9 matchs de playoffs, est à son meilleur à 25 ans, une joueuse qui pourrait exploser ses compteurs aux championnats du monde, où elle a souvent péché par manque d’efficacité. Elle est toutefois au milieu d’une équipe à la puissance de feu redoutable avec les surdouées qui ont émergé, et toujours les Denisa Křížová, Katerina Mrázová, Alena Mills et Nemo Neubauerová pour montrer l’exemple, ainsi que la porte-bonheur Tereza Vanišová. Cette dernière a en effet acquis un troisième titre PHF consécutif… avec un troisième club différent, marquant le but du titre pour Toronto. Et avec Aneta Tejralová, Sára Čajanová, Daniela Pejšová et Dominika Lásková, la défense est entre de bonnes mains.
Mais alors, qu’est-ce qui pourrait arrêter cette « Narodni tym zen » à l’ossature renforcée ? Devant le but, Klára Peslarová avait réalisé un Mondial 2022 absolument remarquable, nommée sur l’équipe All Star de la compétition. Mais sa grave blessure en début de saison avec Brynäs l’a mise au repos forcé, et installé une vraie problématique pour l’équipe nationale. Dans la mesure du possible, Carla MacLeod a testé plusieurs gardiennes en solution de substitution. Viktorie Švejdová et Blanka Škodová ont connu de bonnes performances. Švejdová a blanchi la Suède puis l’Allemagne, mais elle n’est restée que la doublure de Lindsey Post dans son club suédois de SDE, elle a finalement été écartée de la liste. Škodová a quant à elle très peu joué en NCAA, le poste à Minnesota-Duluth étant monopolisé par la Suédoise Emma Söderberg, mais elle a désormais la préférence du staff. Škodová saura-t-elle répondre aux (hautes) attentes de son équipe ? Le poste de gardienne est donc un motif d’inquiétude dans un groupe A exigeant qui ne laisse pas de place à l’imprévu. Mais si la carte devait s’avérer gagnante, la Tchéquie pourrait prolonger sa place dans le groupe A et jouer la médaille.

États-Unis
De 2015 à 2019, les Américaines ont affiché une suprématie indestructible, gagnant quatre championnats du monde et le tournoi olympique de PyeongChang. Mais être privé de victoire finale, c’est une situation qu’elles connaissent désormais, avec trois échecs consécutifs en finale, aux Mondiaux ainsi qu’aux Jeux olympiques de Pékin. La marge est faible par rapport aux rivales canadiennes, trois finales perdues à un but d’écart, mais cela a fait naître une certaine animosité dans cette spirale. Stoppée pendant deux ans, la Rivalry Series, une série de confrontations entre les deux superpuissances nord-américaines étalées sur toute la saison, a repris ses droits. Hilary Knight et ses coéquipières ont de nouveau fait régner la loi, enchaînant trois victoires de rang… avant que le vent ne tourne. Face à des Canadiennes métamorphosées, elles ont subi quatre revers consécutifs, dont deux derniers au Québec qui ont viré à la leçon avec un score cumulé de 1-10. Cela fait désordre. Émoussée mentalement, l’équipe américaine a souvent perdu ses nerfs lors de ces deux dernières défaites 5-1 et 5-0. Knight, qui a mené les compteurs avec 8 points en 7 parties, a prétexté le fait que l’équipe a trop changé au fil des matchs pour rivaliser face à une équipe du Canada bien huilée. Elle n’a pas tout à fait tort dans le sens où l’entraîneur John Wroblewski a testé au total 39 joueuses sur les 7 matchs, soit 8 de plus que l’équipe du Canada. Finalement, qu’importe cette série de la rivalité, tant que le résultat au championnat du monde est au rendez-vous. Mais cette équipe n’a probablement plus le droit à l’erreur.
Pour s’assurer d’avoir les forces en présence à l’instant T, USA Hockey a organisé dans le Minnesota un dernier camp de sélection, une semaine seulement avant le Mondial, en réunissant 46 joueuses. Qu’un tel rassemblement soit organisé aussi proche du championnat du monde augurait d’un vrai chamboulement pour casser la spirale. Et à ce jeu, Wroblewski n’a pas déçu en communiquant l’alignement, qui n’a été divulgué que samedi dernier.
Il était convenu que Kendall Coyne Schofield, capitaine de l’équipe depuis le Mondial 2019, n’y figure pas, et pour une bonne raison. La rapide attaquante de 30 ans, qui a disputé les cinq premiers matchs de la Rivalry Series (et 4 points au compteur), a annoncé le 1er mars qu’elle était enceinte avec une arrivée prévue en juillet. Elle espère bien revenir dans l’équipe américaine par la suite, comme l’ont fait avant elle Jenny Potter et les sœurs Jocelyne et Monique Lamoureux. En revanche, Alex Cavallini, qui a accouché à Noël, était présente au camp mais la gardienne titulaire aux JO de Pékin a fait les frais de l’intransigeance du staff. Ce qui a été possible en équipe du Canada (cf Natalie Spooner) n’est pas possible dans cette équipe américaine. Maddie Rooney, héroïne de l’un des derniers sacres (le titre olympique en 2018) et qui n’a été alignée ensuite que par intermittence devant le but, en a aussi fait les frais, tout comme d’autres visages familiers, Grace Zumwinkle, Jesse Compher et Hannah Brandt.
La logique voudrait que le poste de numéro 1 revienne à Nicole Hensley, qui n’a encaissé que 5 buts en 6 matchs au Mondial 2022. Mais 5 buts, c’est ce qu’elle a finalement encaissé lors du dernier match décisif de la Rivalry Series qui a tourné en faveur du Canada. L’ancienne coéquipière de Chloé Aurard en NCAA, Aerin Frankel, a connu de solides performances pour sa première année en PWHPA et pourrait avoir une carte à jouer avec tout ce qui a l’air d’un nouveau cycle. Grâce à une saison remarquable en NCAA, Abbey Levy de Boston College est parvenue à décrocher le troisième spot devant le but. 13 joueuses retenues proviennent d’ailleurs de la NCAA, la nouvelle vague est là.
Si le championnat du monde 2022 a été un nouvel échec pour les États-Unis, il a vu la naissance d’une nouvelle star, justement issue de NCAA. Avec 18 points (7 buts / 11 passes), Taylor Heise a réalisé une entrée fracassante sur la scène internationale, obtenant le deuxième meilleur total de l’histoire dans une édition du championnat du monde. Le record, 23 points, date de 1990 et était l’œuvre de Cindy Curley. Le coach Wroblewski a eu l’audace de casser le lien qu’avait Heise avec Grace Zumwinkle, complices et co-capitaines de l’Université du Minnesota. En associant Heise à deux « anciennes » de la maison américaine, Alex Carpenter (que Knight a récemment désignée comme la meilleure joueuse du monde) et Amanda Kessel, il a formé le meilleur trio de ce dernier championnat du monde. À 31 ans, Kessel est parvenue à amasser 17 points, l’une des cinq Américaines classées parmi les sept meilleures marqueuses durant ce tournoi. Parmi elles, Hannah Bilka qui disputait, comme Heise, son premier tournoi majeur, et qui a réussi à planter une douzaine de points. Taylor Heise et Grace Zumwinkle ont récolté respectivement 65 et 61 points en NCAA cette saison, le deuxième et troisième meilleur total, mais seule Heise a été retenue.
Les Américaines ont tout de même été moins à leur avantage cette saison durant la Rivalry Series, mais aussi lors des évènements de la PWHPA, l’association créée par les meilleures joueuses nord-américaines et qui a permis d’organiser une petite vingtaine de matchs : dix des douze meilleures marqueuses sont canadiennes. En revanche, Lee Stecklein, une joueuse qui a pris une tout autre dimension depuis quelques années en devenant patronne de la défense américaine, a été élue meilleure arrière de PWHPA 2022-23. Et Stecklein a toujours à ses côtés des soldats comme Megan Keller, Savannah Harmon et Cayla Barnes. Aucune joueuse n’est pour autant indéboulonnable (la preuve par Wroblewski) et certaines ont réussi à s’immiscer dans les lignes dont Rory Guilday et Lacey Eden. Eden a d’ailleurs remporté le championnat NCAA avec l’Université du Wisconsin et trois autres Badgers retenues dans cette équipe : Caroline Harvey, Nicole LaMantia et Britta Curl. Reste à cette nouvelle génération sans titre de faire la différence alors que les États-Unis ont fêté le 25e anniversaire de leur victoire au premier tournoi olympique féminin de l’histoire. Une bonne occasion (comme s’il en fallait une) pour gâcher la fête au Canada, cela signifierait que l’audace aura payé.

Canada
Les Canadiennes sont donc dans les meilleures dispositions, championnes olympiques à Pékin et doubles championnes du monde en titre. Et à domicile à Brampton, elles entendent bien conserver leur souveraineté retrouvée. Le fait d’avoir été mené 3 manches à 0 durant la Rivalry Series face aux États-Unis, avant de réussir un spectaculaire come-back pour remporter la série en sept manches était bon pour la confiance à deux mois du championnat du monde. La dernière victoire au match 7 sur le score de 5-0 est la plus large victoire face aux rivales américaines en l’espace de 18 ans. Pour sûr, l’ascendant psychologique est bien du côté du Canada, dont les grandes lignes restent fidèles aux dernières compétitions.
Derrière ce retour en grâce se trouve toujours Marie-Philip Poulin, formidable athlète de 31 ans qui disputera son onzième championnat du monde. On ne compte plus les moments décisifs à attribuer à « Capitaine Clutch », dont les performances comme l’attitude et les discours ont une réelle influence sur le groupe. Troy Ryan, depuis 2016 derrière le banc canadien en tant qu’assistant puis entraîneur en chef, a un immense respect pour la joueuse, avouant à TVA Sports qu’il s’assurait d’écouter chacune de ses prises de parole. Après ses 17 points inscrits au dernier tournoi olympique, la première de l’histoire (homme ou femme) à marquer dans quatre finales olympiques, Poulin a laissé sa complice Brianne Jenner faire la différence durant la finale mondiale quelques mois plus tard. Cette saison, « Pou » a passé le cap des 200 points (97 buts, 103 passes) en équipe du Canada, un seuil que seules quatre joueuses ont réussi à franchir avant elle. En PWHPA, elle a été élue meilleure attaquante et a été la meilleure marqueuse avec 27 points dont 12 buts en 20 matchs. Elle ne fatigue donc pas dans sa démonstration de force, alors qu’elle compte bien faire partie du cycle olympique pour Milan-Cortina 2026. Et avant cela, elle sera de nouveau le moteur du Canada à Brampton.
Poulin est un talent d’exception, et un autre a pointé le bout de son nez. Une jeune Canadienne qui a le culot de dominer les compteurs dans le championnat universitaire aux États-Unis, c’est le tour de force réalisé par Danielle Serdachny, 21 ans. Capitaine de Colgate University, Serdachny a explosé les statistiques en NCAA en inscrivant la bagatelle de 71 points (25+46), soit 12 points de plus que sa plus proche poursuivante avant les playoffs, et éclipsant les performances d’autres universitaires canadiennes comme Sarah Fillier, meilleure pointeuse canadienne au dernier championnat du monde mais moins efficace cette saison. Le 19 décembre dernier, alors qu’elle ne disputait que son deuxième match sous le maillot à la feuille d’érable, Serdachny, native d’Edmonton, a marqué le but gagnant en prolongation, contribuant alors à la remontée fantastique du Canada dans la Rivalry Series.
La NCAA n’est pas une voie habituellement empruntée par les Canadiennes, en particulier celles qui rentrent dans le programme de l’équipe nationale. Depuis la création de la PWHPA en 2019, la grande majorité de l’alignement provient de cette association. Sarah Nurse, Emily Clark, Brianne Jenner, Kristin O’Neill, Laura Fortino, Blayre Turnbull et Rebecca Johnston en sont, en plus de Poulin, probablement les meilleures représentantes côté canadien à l’heure actuelle. En revanche, absente du dernier Mondial car souhaitant prendre un peu de retrait, puis blessée au dos à l’automne, Johnston a fait un retour remarqué en PWHPA avec 18 points en seulement 15 matchs. La leader de 33 ans a d’ailleurs été rappelée pour la dernière double confrontation de la Rivalry Series… et délivré 2 passes. La présence la plus surprenante concerne Natalie Spooner, 32 ans. Sa nomination dans l’équipe a été révélée trois mois seulement après l’accouchement de son fils, elle n’avait disputé que 5 matchs en PWHPA. Ce choix est dans un sens contesté car il écarte des joueuses probablement plus au summum de leur forme, et l’on pense évidemment en premier lieu au circuit concurrent de la PHF. C’est le cas par exemple de Loren Gabel, l’attaquante du Boston Pride y a survolé le circuit en réalisant une excellente saison avec 40 points en 22 matchs. Gabel, 25 ans, a disputé un championnat du monde en 2019 durant lequel elle avait inscrit 6 buts avant de disparaître de l’alignement. Au Boston Globe, elle avait partagé sa grande motivation pour faire partie de l’équipe, avec le credo « prove people wrong« , c’était dans ses cordes. Gabel n’a finalement pas été retenue. Mais son tort n’était-il pas de quitter l’été dernier la PWHPA, qui à quelques exceptions près fournit les équipes nord-américaines, pour le circuit concurrent de la PHF ?
Autre joueuse, et non des moindres, qui a refait surface après s’être ménagée : Ann-Renée Desbiens. La gardienne de 28 ans avait réalisé des performances impressionnantes après avoir offert le dernier titre olympique puis le dernier titre mondial en 2022. Constatant qu’elle en était ressortie totalement épuisée, physiquement et mentalement, elle voulait s’accorder une pause. À l’horizon des Mondiaux 2023, Desbiens a repris la compétition avec la PWHPA et maintenu une moyenne d’arrêts de 93,5% en 13 rencontres. Alors qu’Emerance Maschmeyer et Kristen Campbell s’étaient partagées la cage pour les cinq premiers matchs de la Rivalry Series, la Québécoise a retrouvé la maison Canada en février, et largement contribué au rayonnement de son équipe en fin de série. Desbiens est probablement, avant le début de ce Mondial, la meilleure gardienne au monde, et devrait donc logiquement assurer la majorité des matchs devant la cage du Canada. Où le public local espère un quatrième triomphe de rang de son équipe.
Voir aussi les résultats de la saison internationale féminine.