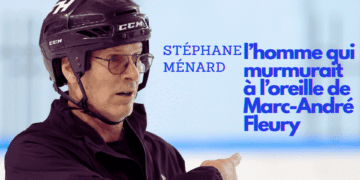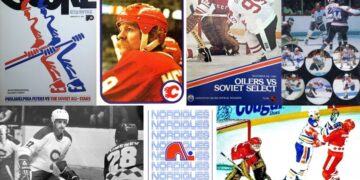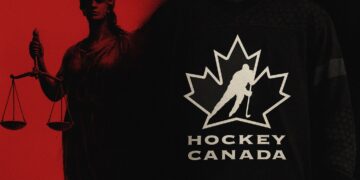Originaire de Trois-Rivières et ancienne hockeyeuse des Dragons du Collège Laflèche, Catherine Laroche, 33 ans, a été victime d’une agression sexuelle en juin 2015 par un joueur évoluant en NHL. Cinq ans plus tard, elle trouve le courage de porter plainte, amorçant un parcours judiciaire long, douloureux et finalement incompatible avec sa guérison. Elle fonde en 2022 Égaux sans égo, une entreprise dont la mission est d’éduquer les jeunes joueurs de hockey à la conscience de soi, au consentement et à la régulation émotionnelle. Car plutôt que de se taire, elle a décidé de parler pour que d’autres ne tombent pas. Entrevue avec une femme courageuse.
– La création de l’entreprise Égaux sans égos est liée à un événement de votre vie impliquant un joueur de la NHL. Quand l’idée de créer ce projet vous est-elle apparue pour la première fois ?
J’ai été agressée sexuellement en 2015, mais je suis allée à la police seulement à partir de 2020, lors de la naissance de ma deuxième fille. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à réfléchir à Égaux sans égo. J’ai décidé de le dénoncer parce que je voulais montrer à mes enfants que lorsqu’il nous arrive quelque chose, on va jusqu’au bout. On ne se tait pas. Mais j’ai vécu énormément d’anxiété. Je sentais, dans mon corps, que le chemin de la justice, ce n’était pas le mien. Je n’aime pas rester dans la mentalité de victime. Pour moi, ce qui est arrivé, c’est surtout le résultat d’un manque d’éducation sur le consentement, sur les limites et sur l’impact de l’effet de groupe. J’ai choisi de créer de la lumière au lieu de rester dans l’ombre.
– Le but de votre entreprise est de créer un espace sécurisé pour des hommes habitués à réprimer leurs émotions dans des vestiaires sportifs. Vu comme cela, la tâche semble difficile…
L’être humain est un miroir. Ce qui nous dérange chez l’autre est souvent ce qu’on rejette en soi, ce qu’on refuse de voir. Une majorité de garçons rejettent leur part féminine, c’est-à-dire leurs émotions. Pourtant, hommes et femmes ont un pouvoir de collaboration. Je ne suis pas là pour écraser les hommes, mais pour qu’on crée une sécurité ensemble. Et la confiance s’installe relativement vite. Ce qu’un joueur devient dans son équipe, il le devient aussi dans sa famille, dans son travail. Si je peux l’aider à être un leader d’impact dans le hockey, je sais qu’il le sera aussi dans la société. Là où c’est plus difficile, c’est au niveau des entraîneurs. Plus on vieillit avec un ego non conscientisé, plus celui-ci devient un mur de briques.
– Vous êtes coach de conscience. En quoi consiste ce rôle exactement ?
Une équipe de hockey, c’est une famille. On y retrouve souvent beaucoup d’énergie « de papa » : la discipline, la structure, l’encadrement. Ce qui manque, c’est l’énergie « de maman » : celle qui accueille, qui régule les émotions, qui calme le système nerveux. Parfois, un entraîneur me dit : « Je vais lui dire ça. » Et je réponds : « Mais tu vas le mettre en échec. » Et là, il me dit : « Ah, j’avais pas vu ça comme ça. » Ce n’est pas une question de genre, l’énergie de maman peut venir d’un homme. Mais c’est une question de présence bienveillante. Une présence douce, rassurante, qui apaise. Il y a des gens pour qui le changement fait peur. Mais ils doivent sentir que mon intention est d’apporter un meilleur soutien aux joueurs.

Oui. Ce que les gars me confient, qu’ils n’oseraient jamais dire ailleurs, c’est : « On se sent comme des mini-entreprises. On ne se sent pas comme des humains. Nos besoins ne sont pas écoutés. » Un joueur m’a dit un jour : « J’avais une commotion. Mon coach voulait que je joue, mais mon corps n’était pas prêt. Sauf qu’il fallait qu’on gagne. » Ces gars-là ont peur. Ils ne parleront pas.
– Pensez-vous que certaines organisations travaillent uniquement pour le paraître ?
Je crois qu’il y a des gens sincèrement bien intentionnés. Mais il y en a encore beaucoup qui travaillent pour le paraître. À la convention de Hockey Canada en novembre 2024, tous les conférenciers étaient dans une réelle volonté de changement. Pour ce qui est des dirigeants, je ne sais pas. Certains sont curieux, d’autres écoutent mais n’intègrent rien. Ils veulent des résultats. Et c’est quand il y en aura qu’ils commenceront à changer.
– Avez-vous des difficultés à trouver des équipes prêtes à collaborer avec vous ?
J’ai lancé énormément de perches. Certaines équipes me disent : « On a déjà un psychologue. » Et je leur réponds : « Mais que vont dire vos joueurs s’ils ne savent même pas quoi dire ? » On est le pont entre le joueur, le psychologue, le coach et le physio.
Un jour, un physiothérapeute m’a dit : « Ce joueur a mal au dos, mais ce n’est pas physique. C’est émotionnel. » D’autres joueurs m’ont dit : « Si on t’avait eue toute l’année, ça aurait tout changé. »
– Vous entrez dans un vestiaire masculin. Avez-vous senti de la méfiance lors de vos premières interventions ?
À chaque fois que je rentre dans une chambre, je dis : « Je ne détiens pas la vérité absolue. Je possède ma vérité. Tu prends ou tu laisses. »
– Vous abordez des sujets comme la consommation, le consentement, la pression sociale. Les jeunes découvrent-ils ces thèmes à travers vous ? Quelles sont leurs réactions ?
Ce qu’ils découvrent vraiment, c’est l’ego. Les autres sujets, ils les ont déjà entendus. Je commence par l’ego parce que tout le monde s’y reconnaît. Ils comprennent enfin pourquoi ils réagissent de telle ou telle façon. Souvent, ils me disent : « La sensibilisation, ça entre par une oreille, ça sort par l’autre. On est tannés. » Moi, j’arrive avec du vécu. C’est facile de dire : « Je n’agresserai jamais personne. » Mais quand tu perds le contrôle de toi-même, quand tu as peur d’être trahi, tu comprends que ça peut t’arriver. Après les ateliers, les gars veulent immédiatement changer, s’améliorer. Ils réalisent qu’il y a beaucoup de travail à faire. Certains me demandent un accompagnement individuel dans un objectif de performance.
– Les entraîneurs aussi ont un rôle à jouer. Que vous confient-ils ?
Ils parlent beaucoup de harcèlement entre joueurs, de complexes d’infériorité ou de supériorité. Il y a des hommes dans ce que j’appelle un “masculin toxique”, et d’autres dans un “masculin castré” si vous me permettez l’expression. Ceux-là se referment, n’osent pas s’affirmer, n’ont aucune confiance en eux. Le toxique, lui, manipule. Avant, il y avait beaucoup de toxiques, comme à mon époque. Aujourd’hui, il y a davantage de castrés. Ils sont remplis d’anxiété, de pression sociale et de performance. Beaucoup de gars admirent Sidney Crosby. Et j’ai hâte d’en entendre un dire : « Je veux être ce qu’il est », et non : « Je veux faire ce qu’il fait. » Crosby inspire. Carey Price aussi, même s’ils ont vu ses failles. Mais il reste avant tout un humain. Il lui manquait peut-être des outils. Peut-être que certains de ses traumas sont remontés.

Oui, mais plusieurs me disent : « On n’a plus de plaisir. » Et ils n’ont que 17 ans ! Je leur dis toujours : « On va reconnecter à la raison pour laquelle tu as mis des patins. » Plus tu es dans le plaisir, plus tu performes. Mais les gars n’osent plus parler. Un jour, des joueurs m’ont dit qu’ils n’avaient pas aimé l’intervention de leur coach. Mais plutôt que de lui en parler, ils me l’ont dit à moi. Je leur ai dit : « Ce n’est pas à moi de le faire. C’est à vous de vous affirmer. » J’ai organisé un atelier. J’ai dit au coach : « Écoute ce que les gars ont à te dire. » Il a trouvé ça difficile. Est-ce qu’il aurait réagi pareil si je n’avais pas été là ? Je ne sais pas.
– Dans les médias, on parle d’équipe, d’organisation, comme si rien n’était plus important que l’image. Est-ce dévastateur pour les joueurs ?
Absolument. Plus l’organisation est grande, plus les garçons sont stressés. Ils savent que s’ils vont à contre-courant, il n’y aura aucune empathie. La majorité des gars que j’ai rencontrés me disent : plus tu montes, plus tu deviens une mini-entreprise. Un joueur m’a même dit qu’en NHL, personne ne se parle, surtout quand tu es « rookie ». Ça crée d’emblée des complexes de supériorité.
– Hockey Canada a été secouée entre 2020 et 2023. Pensez-vous qu’il existe désormais un vrai désir de faire évoluer les choses ?
Oui, chez certains membres. Est-ce que tous ont les mêmes intentions ? Je ne pense pas. Mais tant que ça ouvre des portes, ça me va. Des changements peuvent naître de là.
– L’affaire de 2018 impliquant plusieurs joueurs d’Équipe Canada Junior a pris une ampleur nationale. Pourquoi ce procès est-il si important ?
Malheureusement, comme souvent, les choses peuvent être vite oubliées. Je souhaite que ce procès ouvre des portes aux gens qui œuvrent dans l’éducation. Mais le procès en soi peut vite tomber dans l’oubli. Je me suis demandé : comment se sent cette victime ? Moi, ma détective m’a dit un jour : « On a tout. On l’a. » Et j’ai répondu : « Ce n’est pas ma voie. » Elle m’a alors demandé : « Est-ce que je peux appeler l’agresseur pour lui dire que tu viens de sauver sa vie et sa carrière ? »
– Pensez-vous que ce procès et votre propre histoire révèlent les limites du système judiciaire face aux agressions sexuelles ?
Oui. Mais pour moi, tous les systèmes ont leurs failles. Au fond, tout revient à l’état de l’humain : quand il ne va pas bien, les systèmes s’effondrent. Le système judiciaire n’est pas adapté aux victimes. Même avec le meilleur détective, je n’aurais jamais pu bénéficier de son plein potentiel, parce que ce système use tout le monde. C’est ce qui a dû arriver à ma première détective. J’ai perdu espoir quand mon dossier a été mis sur pause à son départ.
– Si vous pouviez changer une chose, ce serait quoi ?
J’aurais aimé qu’on parle tous les deux avec mon agresseur. Même quand on fait des erreurs, on peut réparer. Il pensait que je voulais de l’attention ou de l’argent, c’est souvent ce que les gens croient. Mais personne n’a envie de ça. Je n’ai jamais pu lui poser mes questions. Alors, si je pouvais changer une chose, ce serait celle-là.