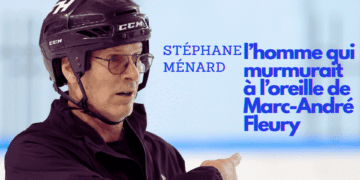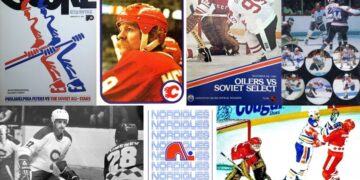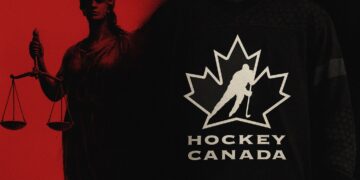Lorsque le vingtième siècle s’achève, la période est propice à l’élection des meilleurs hockeyeurs de tous les temps. Le sondage des lecteurs de Eishockey News élit alors Udo Kießling comme le meilleur défenseur allemand de l’histoire, avec 4921 voix, devançant Uwe Krupp (3871 voix), qui avait pourtant récemment marqué les esprits en 1996 en remportant la Coupe Stanley après avoir marqué le but gagnant en prolongation. Ces deux légendes se respectent et ont été coéquipiers. Kießling est d’ailleurs le joueur qui a laissé le souvent le plus marquant au jeune Krupp, éberlué de le voir faire des pompes et des abdominaux avant chaque entraînement jusqu’à épuisement. Il était l’exception de son époque en matière d’hygiène de vie, « non fumeur militant » (selon le mot de Hans Zach) et modéré dans sa consommation d’alcool.
Udo Kießling a si bien entretenu son corps qu’il fut un modèle de longévité. Il a pourtant joué à une époque où le hockey était particulièrement rude sur les patinoires allemandes. Rien ne lui fut épargné : trois fractures du tibia, trois luxations de la clavicule, trois opérations du coude, cinq commotions cérébrales, 20 dents perdues… et une ultime fracture de la mâchoire qui aura raison de sa carrière. Malgré cela, il est devenu le premier hockeyeur à dépasser la barre symbolique des mille parties jouées dans un grand championnat européen, avec 1020 matches en Bundesliga/DEL. Ce nombre peut paraître banal en Amérique du nord où les calendriers sont plus denses, mais on en mesure mieux la portée quand on ajoute que Kießling fut un temps le recordman mondial des sélections. Il a porté 320 fois le maillot de l’équipe d’Allemagne. Son temps de jeu était aussi énorme, dès le début de sa carrière.
Meneur par l’exemple, devenu capitaine comme par évidence, Udo a dû pourtant se détacher de l’étiquette de « fils de » qui lui colla à la peau dans sa jeunesse. Il était en effet le fils de l’entraîneur national de l’Allemagne de l’Ouest… qui avait pourtant côtoyé les plus hautes autorités communistes avant de déserter de l’autre côté du Rideau de fer.